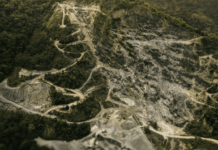Publié chez De Boeck Supérieur, le livre L’économie du réel écrit par David Cayla bouscule quelques vérités économiques ancrées dans cette discipline, semblant parfois quitter terre à force de schémas théoriques hors-sol. Alternant des analyses pointues et des rétrospectives historiques, l’auteur signe un ouvrage ambitieux et abouti dont l’écriture agréable facilite la compréhension. Au détour de quelques pages, la lecture se révèle même franchement plaisante. Mr Mondialisation est allé à la rencontre de l’auteur, à Angers. Entretien.
Mr Mondialisation : Pourriez-vous vous présenter aux lecteurs de Mr Mondialisation ?
David Cayla : Je m’appelle David Cayla, je suis maître de conférence en économie à l’Université d’Angers. Mon travail consiste à enseigner et à effectuer des travaux de recherche. C’est dans le cadre de mon activité de chercheur que je rédige des articles scientifiques et des livres grand public comme L’Économie du réel que je viens vous présenter aujourd’hui. En parallèle, j’ai des activités citoyennes puisque je suis membre du collectif « Les Économistes atterrés », collectif constitué en 2011 pour lutter contre les politiques libérales menées en Europe, et que j’ai rejoint, pour ma part, en 2013.
Mr.M : Quel était votre objectif en écrivant L’Économie du réel ?
D.C : Il y avait d’abord un objectif personnel, celui de faire le point sur mes connaissances en économie – notamment les réponses que j’ai pu trouver au fil de mes études – et sur la manière dont les économistes analysaient le marché. Le thème principal de ce livre, c’est le marché. La question du marché est au cœur des questionnements économiques modernes. Cela n’a pas toujours été le cas comme je le montre dans le livre, et je souhaitais transmettre mes réflexions sur ce sujet, pour le grand public, comme pour mes collègues économistes. Ma volonté était double : rendre le livre accessible à un non-initié, et en même temps le rendre intéressant pour un public aguerri. Ces deux objectifs ont abouti à un ouvrage pointu, mais néanmoins à la portée de toute personne voulant comprendre comment fonctionne la pensée économique. Le livre vise à interroger certains schémas théoriques aussi absurdes qu’indépassables. J’ai la conviction que chacun peut y trouver matière à réflexion.
-

L’économie du réel, aux éditions De Boeck Supérieur
Mr.M : Vous semblez reprocher à la théorie libérale son caractère normatif. Est-ce bien cela ?
D.C : Je ne reproche pas vraiment à la théorie libérale d’être normative, car en réalité c’est une des caractéristiques fondamentales de toute la science économique. Un savoir est dit positif, lorsqu’il s’attache à décrire des phénomènes ; il est normatif lorsqu’il vise à dire ce qu’il faut faire. Or, la science économique poursuit deux objectifs : décrire et proposer. On demande à l’économiste de comprendre les maux, mais également d’y apporter des remèdes. Expliquer les causes du chômage n’est pas la fin des fins de notre discipline ; l’essentiel, c’est de mettre en place des stratégies permettant d’endiguer le chômage, donc d’avoir une approche normative. L’économiste porte deux casquettes à la fois, celle du scientifique qui cherche à comprendre la société, et celle de l’ingénieur qui ambitionne d’agir sur elle.
Le problème aujourd’hui, c’est que le normatif prend largement le pas sur le positif, ce qui éloigne considérablement la science économique de son objet d’étude, la société elle-même. En véhiculant un certain nombre d’idées préconçues comme les bienfaits du libre-échange ou le coût élevé du travail, on finit par ne plus voir le monde qu’au travers de ces prismes. À force de schémas théoriques et de vérités préétablies, l’économiste ne voit plus le monde tel qu’il est, mais tel qu’il se le représente. Mais cela n’est pas propre aux libéraux, beaucoup d’économistes, y compris moi, travaillons avec des a priori logiques. Il faut simplement en prendre conscience pour toujours challenger nos impressions, cela ne peut qu’être bénéfique en termes de démarche scientifique.
Mr.M : Les recettes miracles du FMI, inspirées du consensus de Washington, imposées à tous les pays débiteurs depuis des années, à savoir : réduire les dépenses publiques, privatiser, alléger la fiscalité sur les hauts revenus et sur le capital, ne sont-elles pas une parfaite illustration de cet ascendant du normatif sur le positif, dans l’analyse économique moderne ?
D.C : C’est Joseph Stiglitz qui explique dans son livre La Grande désillusion, que les rapports du FMI étaient déjà écrits, et qu’on les complétait simplement avec le nom des pays comme on remplirait un texte à trous. On avait une solution unique pour tous les problèmes, indépendamment de l’histoire et des institutions sociales spécifiques des pays qu’on mettait sous « ajustement structurel ». On voit bien ici qu’il y a une perte de substance dans l’analyse économique. Mais le problème de cette discipline ne vient pas seulement de son côté normatif. Les modèles théoriques et les systèmes de représentation qui, pour le coup, ne sont pas nécessairement normatifs, dégradent beaucoup la justesse des raisonnements économiques.
La manière dont les économistes se représentent le marché repose parfois sur des consensus, sur l’élaboration de lois comme celle de l’offre et de la demande, qui ne sont pas issues d’une volonté de décrire une situation particulière, mais le fruit de débats internes à la science économique ayant débouché sur des conciliations pratiques. La loi de l’offre et de la demande découle d’un compromis scientifique dans les débats opposant les économistes pro-offre, et pro-demande sur l’origine de la valeur. On a finalement essayé de satisfaire tout le monde en inventant cette loi de l’offre et de la demande, sans la passer au crible de l’expérimentation empirique.
Le caractère normatif de la science économique n’est pas le seul mal. Dans les racines mêmes de notre discipline, on trouve un certain nombre de schémas n’ayant pas été validés par l’expérience de la réalité, mais faisant néanmoins autorité dans le milieu. Le fait qu’il soit difficile de réaliser des expériences en économie laisse les coudées franches aux facteurs extérieurs pour compter dans l’élaboration de ces dogmes. La notoriété, les prix, le prestige, sont alors des éléments qui pèsent de tout leur poids.
Mr.M : N’est-ce pas là une preuve que l’économie est une science humaine avant d’être une science dure ?
D.C : C’est vrai que la science économique s’est toujours pensée comme une science dure. Nombre d’économistes ont d’ailleurs été fascinés par la physique, en particulier la mécanique, d’où l’importance des notions d’équilibre de forces par exemple. Il a longtemps été au cœur de la réflexion économique de singer les concepts d’autres disciplines comme la théorie de la gravitation et les mathématiques, à l’image de l’économiste Léon Walras qui chercha (sans y parvenir) l’approbation du mathématicien Henri Poincaré pour ses travaux. Cette fascination a induit une approche très mathématisée avec un recours important aux équations. Néanmoins, son objet d’étude demeure la société.
La science économique aborde des réalités observables avec une attention particulière pour la richesse, définie comme l’ensemble des biens et services dont on peut disposer. D’où vient la richesse ? Comment est-elle produite et quelle-est sa répartition ? Ce sont là les questions primordiales auxquelles s’intéresse l’économiste. Or, comme c’est une science sociale, et que son objet d’étude est la société humaine, elle doit également prendre en compte les résultats des autres sciences sociales comme l’Histoire, la sociologie ou l’anthropologie, car ce sont des regards différents sur le même objet. Et c’est là que la science économique se trompe à mon sens, car elle s’enferme dans l’entre-soi au lieu de s’ouvrir aux autres sciences sociales. Elle entend comprendre la société à elle seule. Or, même un sujet semblant être l’apanage des économistes comme le marché, réclame une pluralité d’approches pour en avoir une connaissance complète.
Mr.M : Quel doit-être alors la démarche scientifique d’un économiste selon vous ?
D.C : Il faut tout d’abord une approche pluridisciplinaire. Ensuite, comme le laisse entendre le titre de mon livre, un retour au réel est essentiel. Il est nécessaire de partir d’une réalité observable, grâce aux outils statistiques, et ensuite d’utiliser des modèles théoriques pouvant être pertinents dans l’analyse du phénomène réel observé. Je ne suis pas contre l’utilisation de modèle, toutes les sciences en ont, il faut simplement garder à l’esprit qu’un modèle est toujours une simplification qui ne suffit pas, seul, à tout discerner. Or, en économie, et c’est là la critique principale de mon livre, il y a des modèles qui ne renvoie plus du tout à la réalité, qui ne sont presque jamais pertinents pour comprendre les phénomènes économiques, mais que, par conformisme, on continue d’appliquer tout le temps et partout.
Un modèle qui n’est pas capable de se vérifier dans la réalité est un modèle à rejeter. C’est le cas selon moi, de la loi de l’offre et de la demande, une loi qui imprègne les cerveaux de tous les étudiants en économie et qui paradoxalement, n’est jamais capable d’expliquer les variations de prix sur les marchés réels de manière pertinente. Avec cette vérité en tête, on ne peut que partager l’avis de Dani Rodrik invitant les économistes à se montrer plus humbles. Et plus d’humilité pour un scientifique, cela commence par interroger les vérités qui semblent indiscutables dans son microcosme.
Mr.M : Cette loi de l’offre et de la demande, pourriez-vous nous la présenter et nous en souligner les failles ?
D.C : Comme je le disais plus tôt, cette loi – élégante d’un point de vue formel – n’est pas le fruit d’une expérience empirique, mais le résultat d’un compromis entre économistes. Que contient cette loi ? Et bien pour commencer, quand on épluche son contenu, on constate qu’il n’y a pas une, mais trois lois.
Premièrement, il y a la loi de la demande qui dit la chose suivante : lorsque les prix augmentent, la demande baisse et inversement ; lorsque les prix baissent, la demande augmente. Deuxièmement, il y a la loi de l’offre qui montre une relation inverse, à savoir que : lorsque les prix augmentent l’offre augmente et inversement. Autrement dit l’offre est fonction croissante des prix, tandis que la demande est fonction décroissante des prix. Enfin, nous trouvons la loi dite « de l’offre et de la demande » qui énonce que les variations de prix sont les conséquences des déséquilibres entre l’offre et la demande. Elle s’attache donc, non pas à expliquer l’évolution de l’offre ou de la demande, mais les variations de prix de la manière suivante : lorsque la demande est supérieure à l’offre, les prix augmentent ; lorsque la demande est inférieure à l’offre, les prix diminuent.
On a affaire à un triptyque visant à expliquer à la fois les variations de l’offre, les variations de demande et enfin les variations de prix. L’idée derrière tout cela, c’est que, dans un marché de concurrence parfaite, les variations entre l’offre et la demande doivent mener à un prix d’équilibre, lesquels permettent à toute la demande d’être pourvue en offre.
Ce que je reproche à ces lois, c’est d’abord leur côté circulaire. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les deux premières lois affirment que les quantités sont fonction des prix, tandis que la troisième loi nous explique l’inverse, que les prix varient en fonction des quantités. Le problème avec les lois circulaires, c’est que l’on arrive à des résultats insensés. Si je constate par exemple que le prix et la demande d’abricot ont tous deux augmenté, je vais faire un lien de cause à effet en disant que c’est parce que la demande a augmenté que le prix a augmenté à son tour. Ici, la demande a déterminé le prix. Si je prends une situation radicalement opposée, mettons que la demande d’abricots baisse alors que le prix augmente, je vais conclure que c’est parce que le prix a augmenté que la demande a baissé ; cette fois, c’est le prix qui a déterminé la demande. Vous comprenez où je veux en venir ? Peu importe dans quel contexte et dans quel sens les prix varient, la loi de l’offre et de la demande trouve toujours une solution pour l’expliquer. Une loi qui permet d’expliquer deux phénomènes contraires, c’est une loi qui n’est pas scientifique, car elle n’explique rien. Et pourtant, elle fait autorité dans les études économiques.
-

David Cayla lors d’une conférence sur la Loi Travailc
Un autre problème que pose cette loi, c’est que l’offre et la demande – en particulier la demande – sont non quantifiables dans la réalité. C’est là ma deuxième critique, l’offre et la demande sont des abstractions. Comment calculer la demande ? Regarder le nombre d’achats n’est pas suffisant, car il y a peut-être une demande qui n’est pas satisfaite. Quelle-est aujourd’hui, en France, la demande en baguettes de pain ? Comment la quantifier ? Je peux regarder le nombre d’achats de baguettes de pain à l’échelle nationale, mais comment être sûr qu’il n’y a pas eu des acheteurs n’ayant trouvé que des étales de boulangeries vides ? En réalité, la demande est non-quantifiable. Concernant l’offre, il devrait suffire de regarder la production précédant les ventes, sauf que dans certains secteurs d’activité l’offre est subordonnée à la demande, cela devient donc impossible. Chez le coiffeur par exemple, l’offre est toujours égale à la demande, il n’y aura pas d’offre de coupe non pourvue. La conclusion de mon raisonnement est la suivante : la loi de l’offre et la demande ne peut être validée empiriquement, car elle s’appuie sur des éléments qui ne sont pas observables. Une telle loi, je le répète, ne peut pas être scientifique. Cela ne signifie pas que les prix n’ont pas d’incidence sur l’offre et la demande et vice versa, il s’agit d’une conjecture pouvant parfois éclairer une situation précise, mais en aucune manière il est pertinent d’en faire une loi scientifique.
Mr.M : C’est pourtant cette même loi qui sert à expliquer la persistance du chômage sur un marché spécifique qu’est celui du travail. Le manque d’emploi viendrait d’un déficit de demande de travail des entreprises par rapport à l’offre en raison d’un coût du travail trop élevé. Comment cette analyse théorique influence-t-elle les décisions publiques en matière de lutte contre le chômage ?
D.C : Appliquer la loi de l’offre et de la demande sur le marché du travail pose énormément de problèmes, car le travail n’est pas une marchandise, ou alors il est – comme le suggère Polanyi – une marchandise fictive. Une marchandise est réalisée dans le but d’être vendue. Or le travail est un objet purement social, on ne fait pas des enfants dans le but d’augmenter l’offre de travail, et on ne vend pas son temps travail parce qu’on a trop de temps pour soi. C’est ce qui le distingue du marché de l’abricot. L’abricot est produit et destiné à la vente. Ce n’est pas du tout le cas du travail. Dès lors, peut-on réduire le marché du travail à des considérations mercantiles dans une société où le statut social d’une personne dépend énormément de son activité professionnelle ? La loi de l’offre et de la demande fait abstraction de tant d’éléments (nécessité du travail, statut social, développement personnel, etc.) qu’elle ne conçoit plus ce fait social autrement que comme une marchandise.
En réduisant le travail à un rapport marchand, on conclut que s’il y a trop d’offres de travail par rapport à la demande, c’est que les salaires sont trop élevés. Comme pour les abricots, c’est parce que le prix du travail est élevé que la demande diminue, donc il faut baisser le coût du travail pour stimuler la demande, réduire les rigidités, flexibiliser le CDI. D’une part, c’est une analyse simpliste, car elle ne prend pas en compte toutes les subtilités de ce marché complexe ; d’autre part les conséquences qu’on en tire ne conviennent ni aux salariés, car elles créées de la précarité, ni aux entreprises qui perdent en stabilité. Enfin, l’expérience n’a jamais validé le bienfait de ces mesures.
Les seuls gagnants d’une telle représentation, ce sont les grandes entreprises qui affermissent leur domination sur la main-d’œuvre dans l’optique de gagner en pouvoir de négociation, de diminuer les salaires et au final d’augmenter leurs profits. Il est évident qu’une telle approche du marché du travail ne profite qu’à une toute petite minorité. Or, si l’on admet que la science économique doit proposer des solutions, celles-ci devraient relever l’intérêt général.
Mr.M : Dans L’Économie du réel, vous critiquez également le concept d’homo œconomicus. D’où vient ce concept et pourquoi vous dérange-t-il ?
D.C : Le concept d’homo œconomicus, est une conséquence de l’individualisme méthodologique adopté, par l’école néo-classique. Concrètement, c’est un concept qui tend à expliquer tous les phénomènes sociaux à partir des actions individuelles. Le présupposé de cette théorie, c’est que les individus d’une société n’agissent que dans leur intérêt propre en effectuant des arbitrages entre ce qui leur rapporte le plus. Ainsi, les fluctuations économiques seraient les résultats de la somme collective de ces ambitions individuelles. Il convient donc, pour que fonctionne cette théorie, d’analyser un ensemble de comportements types pour prévoir les conséquences que peut avoir la recherche des intérêts individuels sur l’ensemble de la société.
» Considérer uniquement l’homme comme une créature économique, c’est nier son humanité «
Mr.M : L’intérêt de l’homo œconomicus serait donc de pouvoir mettre un profil type en face d’une situation théorique pour en tirer les conséquences probables ?
D.C : Exactement, il s’agit simplement de comprendre et de prévoir le comportement humain. Pour cela on crée, bien entendu, différents types d’individus ayant des intérêts différents en fonction, par exemple, de leur catégorie sociale. Mais ce que je reproche à ce modèle, c’est de mettre à jour un « homo » extrêmement nu, qui n’a pas toutes les complexités d’un individu réel. On passe ainsi sous silence les comportements spontanés des individus observables dans la réalité. Nous ne sommes pas toujours dans un rapport marchand au monde, car notre but premier, c’est de tisser des liens sociaux avec notre environnement extérieur. Sauf que le plus souvent, le lien économique détruit le lien social. Ils sont antinomiques. Ce qui signifie que l’analyse économique va laisser de côté ce qui est pourtant déterminant dans le comportement humain : le caractère social de l’individu.
Il y a une anecdote éclairante dans mon livre, tirée d’une étude des économistes Uri Gneezy et Aldo Rustichini. Les responsables d’une crèche avaient jugé bon de sanctionner d’une amende les parents qui venaient récupérer leurs enfants en retard, pour les inciter à faire plus attention. L’effet produit fut l’inverse de celui attendu. Le nombre de retards a augmenté au lieu de diminuer. Ici, l’économie néo-classique est incapable de comprendre cette situation, car elle va à l’encontre de son analyse des comportements humains. La recherche de l’intérêt des parents ne devrait pas être de perdre de l’argent ; dans le schéma théorique de l’homo œconomicus, c’est un non-sens. En réalité, le phénomène social qu’on observe ici, c’est qu’en mettant un prix sur un préjudice, les responsables de la crèche d’Haïfa ont transformé une relation sociale fondée sur le respect des personnes en un rapport marchand. En mettant un prix sur le préjudice, les parents se sont sentis plus légitimes à arriver en retard.
Ainsi, doit-on voir d’un bon œil l’extension toujours plus grande des rapports marchands entre les individus ? Je ne pense pas, car les individus d’une société se comportent d’eux-mêmes correctement en raison de valeurs morales qui dépassent souvent leurs intérêts particuliers. Un chômeur est rarement un fraudeur. Bien souvent, il préfère avoir un emploi même si celui-ci le contraint à respecter des horaires difficiles et ne lui rapporte au final que très peu par rapport à sa situation de chômeur. Car le travail n’est pas qu’une question de revenu, c’est aussi une question de dignité. C’est en cela que les adeptes de l’Homo œconomicus ont tort. Ils ne perçoivent que les systèmes incitatifs de type marchand et sont aveugles aux systèmes sociaux. Il est inquiétant de voir cette conception infuser la société et influencer certaines décisions, comme le fait de tarifer les visites des postiers à domicile, ou de récompenser par des primes certaines tâches inhérentes au travail des fonctionnaires, autrefois effectuées par sens civique, aujourd’hui abandonnées en dépit des incitations financières. Considérer uniquement l’homme comme une créature économique, c’est nier son humanité.
Mr.M : Dans L’Économie du réel, vous consacrez une grande place à l’analyse du marché agricole. Vous analysez le paradoxe de la mécanisation avec notamment cette phrase « du point de vue de l’agriculteur, la malédiction, c’est le progrès ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
D.C : Cela me semblait important d’aborder ce sujet dans mon livre, car, à mon sens, on ne parle jamais assez de l’agriculture et de ce qu’il s’y passe. Dans les manuels d’économie (comme dans le best-seller de Gregory Mankiw et Mark Taylor, Principes de l’économie), on présente souvent le marché agricole comme un marché parfait. Les agriculteurs seront contents de le savoir, quand on sait qu‘il n’y a aucune autre catégorie d’actif en France qui subit autant les effets néfastes du marché ! Depuis le milieu des années 90, on a profondément changé la Politique Agricole Commune (PAC), dans une logique de dérégulation et de mondialisation des marchés agricoles. Cela n’a pas changé grand-chose du point de vue du consommateur, mais a conduit au désastre pour les agriculteurs. Il leur est désormais impossible de vivre de leur travail ce qui atteint profondément leur dignité en tant que travailleur. Soumis à la concurrence mondiale, ils sont la partie faible sur la table des négociations, car les centrales d’achats peuvent faire varier les prix en jouant sur la concurrence, locale et étrangère. Résultat, beaucoup ne survivent que grâce aux aides qu’ils perçoivent. La situation catastrophique du monde agricole illustre l’incapacité d’un marché dérégulé à satisfaire tous les protagonistes.
Le marché agricole ne permet pas la sécurité des exploitations et ne protège pas des faillites. Il ne profite pas non plus aux consommateurs, car la concurrence réduit au maximum les coûts de production, donc la qualité s’en ressent. Enfin, il y a une destruction de l’environnement liée à cette course à la compétitivité qui est absolument terrifiante.
La phrase que vous citez illustre le problème structurel que l’on rencontre dans le secteur de l’agriculture. Quoi qu’il arrive, la demande sur le marché de l’agriculture est stable, car les besoins physiologiques varient peu et dépendent surtout de la taille de la population. On ne va pas se mettre à manger plus parce que les prix sont faibles, ou moins parce que les prix sont élevés. On mange les quantités qui sont nécessaires à notre survie. Point.
Quand on mécanise l’agriculture, on augmente les volumes de production tout en se heurtant à une demande qui n’est pas élastique. Ainsi, la rencontre de ces deux phénomènes conduit généralement à un effondrement des prix. Les agriculteurs cherchent à compenser cette baisse de prix en augmentant leurs productions, via des investissements massifs dans la mécanisation. Mais cette production excédentaire entraîne à son tour une nouvelle baisse des prix. C’est un cercle vicieux qui détruit le monde agricole tout en poussant chacun dans la voie d’un productivisme effréné.
Sous l’ancienne PAC, les agriculteurs bénéficiaient d’un prix garanti sur la vente de leur production, ils sont soumis aujourd’hui aux prix du marché et ne sont pratiquement plus protégés contre les variations des prix. Sur le plan écologique, les consommateurs sont également perdants, car il devient difficile, dans un contexte de concurrence mondiale, de mettre en place des restrictions environnementales contraignantes sans rendre les coûts de production plus élevés et donc sans enrayer la compétitivité de l’agriculture française. Si l’Union européenne interdit l’utilisation du Glyphosate, mais autorise l’importation de légumes canadiens dont les champs ont été désherbés grâce à ce même produit, il est évident que les producteurs français ne pourront jamais rester compétitifs.
» La situation catastrophique du monde agricole illustre l’incapacité d’un marché dérégulé à satisfaire tous les protagonistes «
Mr.M : Quelle serait la solution selon vous ?
D.C : Revenir à l’ancienne PAC en introduisant de nouveau l’achat des produits agricoles à prix fixe, à condition que les surplus ne soient pas exportés dans les pays africains comme ce fut le cas des poulets congelés à l’époque de l’ancienne PAC. Il ne faut pas, sous prétexte de sauver notre agriculture, aller anéantir celle des pays voisins. En échange de prix garantis pour la production agricole, on impose de strictes réglementations en matière écologique et on se protège de la concurrence internationale en interdisant l’importation de produits agricoles dont la production n’est pas vertueuse socialement et écologiquement.
Mr.M : Vous reprochez également à la science économique de ne s’intéresser qu’aux questions relatives au marché.
D.C : Ce que je reproche à l’économie dominante, c’est d’avoir tourné le dos à une tradition ancienne, la tradition d’Adam Smith, qui consiste à s’intéresser profondément au travail et à l’organisation du travail. Le marché est présent dans la pensée de Smith, bien entendu, mais le travail occupe également une place centrale dans son œuvre. On occulte peut-être trop souvent aujourd’hui cet élément fondamental. Ne réfléchir qu’en termes de marché, cela revient à appauvrir la science économique et aveugle les économistes. La phrase de Jean Tirole « L’économie, de façon plus générale, étudie la rencontre de l’offre et de la demande », illustre parfaitement cette réduction de l’analyse économique aux bornes du marché. Il est fort probable qu’avec de telles œillères, nous passions à côté de bon nombre d’objets d’études non moins fondamentaux.
Mr.M : Dans votre conclusion, vous dégagez un « bloc bourgeois » du reste de la population. C’est une façon de réactualiser le principe de lutte des classes ?
D.C : J’emprunte cette expression de bloc bourgeois au livre de Bruno Amable et Stefano Palombarini L’Illusion du bloc bourgeois. Cela désigne plus une catégorie politique qu’une classe sociale. Il s’agit de la population des 30%, vivant bien le système économique actuel. Les membres de ce bloc se retrouvent davantage derrière des conditions de vie – ce sont des cadres supérieures, vivant dans de grandes métropoles et, partageant souvent les mêmes représentations du monde – qu’autour d’une fonction sociale commune. Il y a une catégorie de la population qui soutient le système actuel, car le système, tel qu’il fonctionne, leur est profitable. Emmanuel Macron est l’archétype du candidat pour qui ils vont voter : libéral, rassemblant le centre gauche et le centre droit. La politique est l’art de gérer les conflits d’intérêts. Or, il y a aujourd’hui un conflit d’intérêts flagrant entre ce bloc bourgeois et les aspirations des 70% restants de la population, laquelle ne parvient pas à se retrouver derrière une même force politique commune capable de renverser la première, bien plus uniforme, elle, du point de vue idéologique. C’est l’une des raisons qui fait la force du macronisme : l’absence d’une alternative politique crédible.
Mr.M : Plus loin dans votre conclusion, on trouve la phrase suivante : « l’alliance libérale-populiste se présente comme la façon la plus simple de mettre en œuvre le projet libéral » …
D.C : La réflexion sur le bloc bourgeois m’a amené à m’interroger sur l’avenir de la démocratie. Le rapport à la démocratie est l’une des questions que sous-tend ce livre. En effet, je critique une idéologie dominante, qui a imposé sa vision du monde aux grands dirigeants tout en fermant le débat politique sur les questions économiques. On dit aux citoyens : « vous êtes en démocratie, vous pouvez choisir vos dirigeants, mais il n’y aura jamais qu’une seule politique économique possible ». Peu nombreux sont ceux qui valident les politiques économiques menées ces dernières années, car peu en ont vraiment profité, sauf les 30% de ce bloc bourgeois. Cela nous amène à nous interroger sur la soutenabilité d’une telle dérive. La réponse est simple. La seule façon de rendre cette situation soutenable c’est de contraindre la démocratie en la contournant. D’où cette idée d’une alliance libérale-populiste que j’emprunte à un philosophe belge, Jean de Munck. C’est une manière de faire accepter au plus grand nombre une politique économique qui dessert ses propres intérêts. Bien que je ne sois pas politologue et que de ce fait, je n’ai pas de légitimité particulière pour évoquer ce sujet, il s’agissait surtout pour moi de souligner le caractère antidémocratique de l’économie libérale et le danger que représente cette idéologie pour la société à laquelle la grande majorité aspire.
Mr.M : Merci pour ces précieuses informations. Auriez-vous un dernier message à faire passer aux lecteurs de Mr Mondialisation ?
D.C : Cultivez-vous, tant sur le plan scientifique qu’artistique. Soyez curieux de ce que les autres ont à vous offrir en termes de connaissance, cultivez-vous, c’est essentiel.
– Propos recueillis par T.B.
Nos travaux sont gratuits et indépendants grâce à vous. Afin de perpétuer ce travail, soutenez-nous aujourd’hui par un simple thé ?☕