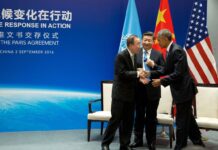Avec 14,5% des émissions de gaz à effets de serre à l’échelle mondiale, l’élevage industriel est l’un des secteurs les plus néfastes pour l’environnement. Outre la pollution de l’air, cette activité est également synonyme de déforestation, de cruauté animale, de dégradation des eaux et d’exploitation des agriculteurs. Aujourd’hui, tous les experts s’accordent pour dire que la production industrielle de viande et de produits animaux doit baisser drastiquement pour affronter sérieusement la crise écologique. Une enquête du Bureau odef Investigative Journalism révèle pourtant que les principales banques de développement du monde ignorent délibérément ces appels. Au total, la BERD et l’IFC ont ainsi versé pas moins de 2,3 milliards d’euros à l’industrie de la viande et des produits laitiers sur la dernière décennie…
À l’heure actuelle, 75 % des terres agricoles du monde sont consacrées à l’élevage du bétail et à la culture de leur nourriture. Autant dire qu’une majorité écrasante des surfaces cultivables sont utilisées pour nourrir des animaux plutôt que des hommes. La surproduction de viande et la place démesurée qu’elle occupe dans le régime alimentaire des populations les plus favorisées du globe exercent une pression dramatique sur l’environnement, qui déstabilise les écosystèmes à travers le monde.
Des ravages à plusieurs niveaux
La cruauté animale, inévitable dans des structures qui placent la productivité et la rentabilité au-delà de toute autre considération, devrait à elle-seule suffire à engendrer un changement de mentalités et de pratiques qui mèneraient à terme à l’arrêt du modèle industriel dominant. Mais d’autres arguments viennent appuyer cette nécessité, à commencer par l’impact de l’élevage industriel sur l’atmosphère. À l’échelle mondiale, il représente aujourd’hui près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que l’ensemble du secteur du transport, auquel le système agroalimentaire mondialisé contribue par ailleurs dans une large mesure.
Au Brésil, par exemple, le soja qui y est produit en masse sert à nourrir le bétail sur place, mais il est aussi en grande partie exporté pour les animaux d’élevage étrangers. Cette agriculture intensive est ainsi la première cause de la déforestation en Amazonie, l’un des écosystèmes les plus riches de la planète. D’après les chiffres de Greenpeace, 63% des terres défrichées de la forêt amazonienne du Brésil le sont à cause de l’élevage. Ce phénomène nuit non seulement à la biodiversité, mais contribue aussi au dérèglement climatique. L’élevage industriel est par ailleurs un facteur important de gaspillage et de pollution de l’eau. La production de viande et d’autres produits animaux exige en effet des quantités d’eaux énormes, et rejette dans les rivières et les fleuves des polluants de toutes sortes.

Surproduction et surconsommation
Les faits parlent d’eux-mêmes : la production de viande et de produits laitiers est bien trop importante pour que le modèle soit soutenable à long terme, d’autant plus que la consommation de produits animaux révèle les inégalités majeures entre les pays riches et les plus défavorisés. Tandis que la population de ces derniers meurt de faim, la consommation de viande, tout comme le gaspillage alimentaire, est toujours en nette progression dans les pays occidentaux depuis plusieurs décennies. Cette surconsommation est induite par la surproduction, qui tire les prix vers le bas, elle-même inhérente à un modèle capitaliste basé sur la croissance infinie. Les entreprises du secteur produisent toujours plus, et inondent les consommateurs de publicités destinées à écouler leur production. Là où il était hier normal en Europe de manger un steak de qualité une fois par semaine ou du saumon frais seulement pendant les fêtes, le recours à la viande est aujourd’hui pratiquement quotidien, sans limite. Le consommateur est roi.
Représentantes ultimes de ce système sclérosé, une poignée de multinationales continuent de s’enrichir sur le dos de ce régime alimentaire, écrasant les petits producteurs sur leur passage. Car une production à taille humaine implique des prix qui ne rivalisent plus avec les normes du marché globalisé. Ces multinationales détiennent aujourd’hui un quasi-monopole pour l’achat, la transformation et la distribution des produits agricoles. Malgré de multiples aides financières, même les éleveurs engagés dans le modèle industriel se retrouvent souvent pris au piège entre des prix du marché toujours plus bas et des coûts de production qui augmentent.
Des milliards d’euros pour les multinationales du secteur,
Au-delà des appels de nombreux experts, le bon sens voudrait donc que ce système ne soit, a minima, plus encouragé par les institutions. Au lieu d’investir dans des modes de production plus durables et plus équitables, les grandes banques d’aide au développement international continuent pourtant d’investir des sommes folles dans l’élevage industriel. Un comportement d’ailleurs bien peu différent pour ce qui concerne les énergies fossiles. C’est ce que révèle une importante enquête du Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en partenariat avec The Guardian et le média d’investigation français Disclose. Leur travail s’appuie sur l’analyse des données publiques publiées par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Société financière internationale (IFC), l’une des structures du Groupe de la Banque mondiale.
Ces deux organismes, censés stimuler la croissance des pays en développement, sont financés par des fonds publics provenant de 189 États, dont la France est l’un des cinq premiers bailleurs. D’après l’enquête, l’IFC et la BERD auraient investi 2,3 milliards d’euros dans les élevages de porcins, bovins et volailles et les filières de transformation ces dix dernières années. Indirectement, c’est donc la collectivité qui inonde d’argent l’industrie de la viande. Les journalistes de Disclose notent par ailleurs que les investissements directs, les prêts et autres outils financiers à disposition des deux banques « ont été largement mis au service de l’expansion des multinationales actives dans le secteur du lait et de la viande. »
La filière laitière, principale bénéficiaire
Ce soutien financier a donc permis la construction, par les géants de l’agrobusiness et leurs filiales, d’abattoirs industriels et de fermes-usines. Les données révèlent que c’est la filière laitière qui a récolté le plus d’investissements, avec pas moins de 890 millions d’euros investis dans le développement de fermes et d’entreprises de transformation de produits laitiers. Les filières de la volaille et du porc ont de leur côté perçu 445 millions d’euros chacune.

Les organismes de développement ont ainsi fait bénéficier de leurs largesses des entreprises bien connues, aux chiffres d’affaires déjà considérables, comme Danone et Lactalis pour la France. En 2010, la BERD avait soutenu les opérations de Danone pour ouvrir de nouveaux marchés en prenant une participation dans les filiales d’Europe de l’Est et d’Asie centrale du groupe. Le groupe Lactalis, impliqué dans plusieurs scandales ces dernières années, avait pour sa part obtenu un prêt de 15 millions d’euros de la part de la banque européenne en 2016. L’objectif : permettre à sa filiale Foodmaster d’augmenter sa production de produits laitiers au Kazakhstan. Partout, un seul mot d’ordre : produire plus.
Des investissements contradictoires avec la mission des organismes
Le financement de ces entreprises est d’autant plus navrant qu’il entre en contradiction totale avec les engagements pris par la BERD et l’IFC en termes d’investissements écoresponsables et de développement durable. L’IFC se targue par exemple de « montrer la voie en créant des normes environnementales et sociales exigeantes (…), et en appuyant des modèles d’activité novateurs ». Contacté par le TBIJ pour le questionner sur ce paradoxe, l’organisme financier soutient que l’industrie de l’élevage est un pilier de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté dans un grand nombre de pays, tout en reconnaissant « l’empreinte environnementale et climatique importante » du secteur. Mais quelle sécurité alimentaire restera-t-il alors que les effets du changement climatique menacent justement cette sécurité. L’abondance industrielle, fruit d’une importante soumission aux énergies fossiles, n’est-elle pas une illusion dangereuse ?
Même son de cloche du côté de la BERD, qui affirme par ailleurs que le financement de ces multinationales ne représente que 1% de ses investissements commerciaux. La banque européenne insiste elle aussi sur l’importance des produits animaux dans l’équilibre alimentaire des populations défavorisées. Mais si l’on suit cette logique, qui ressemble plus à de la communication rondement étudiée, les investissements des banques de développement devraient être entièrement consacrés aux pays où la consommation de viande reste faible. Or, les journalistes d’investigation ont constaté qu’une partie seulement de ces investissements concerne des pays où cette consommation par habitant est faible. Les industries d’autres pays comme l’Ukraine ou la Chine, dont les populations consomment déjà beaucoup de produits carnés, ont ainsi été elles aussi largement soutenues par les banques. La lutte contre la faim servirait-elle alors à camoufler le financement collectif de multinationales ?
Quand bien même, on voit mal comment le financement de multinationales et l’investissement dans le système agroalimentaire mondialisé peut contribuer au développement des pays en question. La résilience alimentaire devrait au contraire s’articuler autour de la subsistance locale et du droit de chaque société humaine à définir son propre système agricole, adapté aux réalités écologiques du terrain. L’agriculture écologique, même si elle est moins productive, ne devrait-elle pas être encouragée pour participer à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables ? Sa mise en œuvre pourrait mettre de nombreux pays sur la voie de la souveraineté alimentaire, mais elle implique d’emblée de réduire la part des terres consacrées à l’élevage industriel tel qu’il est financé par les banques de développement.
Raphaël D.