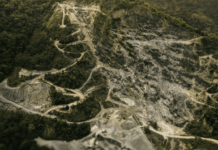Après un vaste plan de relance de 1 900 milliards, un nouveau plan d’investissement de 2 300 milliards de dollars est en discussion actuellement outre-Atlantique. Au-delà des montants colossaux mobilisés, la manière dont le Président Joe Biden envisage l’économie est à rebours des logiques néolibérales : retour de l’État dans le marché, hausse des impôts, lutte contre la pauvreté, contribution des hauts revenus. Une nouvelle ère économique s’ouvre-t-elle au États-Unis ? On vous dit tout.
Quelques jours seulement après son investiture, celui que Donald Trump surnommait « Sleepy Joe » défrayait la chronique économique en annonçant un vaste plan de relance de 1 900 milliards de dollars pour faire face aux répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. Le 29 mars dernier, c’est un second plan d’investissement que le nouveau Président soumettait au vote du Congrès. Ce sont alors pas moins de 2 300 milliards de dollars qui devraient être mobilisés, sur huit ans, pour financer la transition écologique et transformer l’économie américaine.

« Un nouveau paradigme » affirme celui qui se réclame d’une filiation avec Franklin Roosevelt, Président emblématique des États-Unis et père du « New-Deal », cette ambitieuse politique économique initiée pendant la Grande Dépression des années 30. Les économistes les plus enthousiastes voient dans ces deux plans de relance – et dans la manière dont ils devraient être orchestrés – un retour de l’État dans le jeu économique et un signe de la mort imminente du néolibéralisme au profit d’un retour à la social-démocratie d’après-guerre. Joe Biden sera-t-il le symbole de ce changement de paradigme économique, tout comme l’ont été Ronald Reagan et Margaret Thatcher en leur temps ? Cette vaste relance économique peut-elle suffire à relever les défis qui nous font face ? On fait le point.
La lutte contre la pauvreté au cœur de la stratégie économique.
Les trente dernières années ont vu les inégalités de richesse se creuser au sein des pays développés ayant libéralisé leurs économies, en particulier aux États-Unis. Le néolibéralisme, en privilégiant la stimulation de l’offre (les entreprises et l’investissement) pour dynamiser l’économie toute entière, par « ruissellement », a finalement conduit, dans le monde entier, à l’enrichissement d’une élite au détriment du reste de la population. L’argent confié sans conditions aux entreprises a nourri la spéculation aux dépens de l’investissement dans l’économie réelle, entraînant, dans les pays à PIB élevé, une explosion de l’épargne et un tassement de la croissance.

C’est donc avant tout par la lutte contre la pauvreté que Joe Biden entend relancer l’économie de son pays, renversant les stratégies propres au néolibéralisme. Le pari est le suivant : en soutenant la consommation des ménages et la demande, l’investissement et l’offre s’ajusteront, offrant des créations d’emplois et une croissance soutenue. L’une des mesures emblématiques de son plan est la distribution d’un chèque de 1 400 dollars à tous les ménages gagnant moins de 75 000 dollars par an ; soit environ 400 milliards distribués directement aux Américains. A cela s’ajoute une prolongation du complément de 300 dollars sur les allocations chômage. Le plan d’investissement entend, pour sa part, injecter 213 milliards sur huit ans dans le logement social. De son côté, la Réserve fédérale américaine (FED) a inscrit la lutte contre le chômage parmi ses missions prioritaires. Au-delà du nouveau gouvernement, c’est au sein même de la technostructure que la nécessité de penser différemment l’économie semble avoir émergé.
Ces mesures de soutien ne visent pas seulement à pallier les effets de la crise sur la consommation. Durant la pandémie de Covid-19, le pouvoir d’achat des ménages américains n’a pas été nettement attaqué, il a même augmenté par endroits grâce aux mesures de soutien. Ce que propose Joe Biden n’est donc pas la restauration de l’ordre ancien en recréant les conditions de son existence, mais bien une nouvelle feuille de route.
En France, sur les 100 milliards mobilisés, seuls 800 millions d’euros sont destinés aux plus pauvres, soit 0,8 % seulement du plan de relance. La réforme de l’assurance-chômage, qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet, affaiblira directement le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. Pour rappel : 800 000 chômeurs devraient voir leurs prestations être amputées de 20 % dès cet été. Le rapport de la Commission Arthuis sur la gestion des finances publiques préconise, quant à lui, des coupes budgétaires pour enrayer la dynamique d’endettement. Des orientations qui devraient fortement atteindre le pouvoir des ménages, une tactique à contre-courant de l’orientation américaine. La France, en roue libre, s’obstine dans une fuite en avant néolibérale.
Une révolution fiscale.
Bien entendu, pour financer ses plans de relance et d’investissement, Joe Biden compte emprunter sur les marchés financiers en profitant des taux historiquement faibles, comme beaucoup d’autres pays par ailleurs, mais dans des proportions néanmoins considérables. La peur de l’inflation n’est plus la psychose qui freine toute ambition d’investissement public ; pas plus que le spectre de la dette, vieux totem de la pensée néolibérale.
Fait plus notable, au-delà d’un emprunt sur les marchés, Joe Biden entend financer en partie son plan d’investissement par le biais d’un réajustement de la fiscalité. Une « révolution fiscale », qui devrait commencer par une mise à contribution des entreprises, via une augmentation de l’impôt sur les sociétés, passant de 21 % à 28 %. Certes, cette hausse est à relativiser. En effet, avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche, cet impôts atteignait 35 %. Même en le ramenant à 28 %, le taux reste historiquement très faible par rapport à ce qui pouvait se faire dans les années 1960 où il dépassait régulièrement les 50 %.

Néanmoins, une telle hausse des impôts sur les sociétés n’avait pas été constatée aux États-Unis depuis 1950. Cela s’inscrit en rupture avec ce que professent les partisans du néolibéralisme qui, quarante années durant, presque à l’unisson, n’ont eu de cesse de pointer les répercussions négatives de la fiscalité sur l’investissement. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis vont renverser la donne en tablant sur une redistribution des richesses pour stimuler l’activité nationale. Comme l’analysait le journaliste Romaric Godin sur Médiapart, dans la stratégie économique américaine : « l’entreprise n’est plus conçue comme le seul centre de l’économie, pouvant par la magie de la recherche de la maximisation du profit, tout faire ». Une taxe spécifique pour les revenus de plus de 400 000 euros par an est également sur la table dans le but de favoriser la réorientation de l’épargne vers l’économie réelle.
Pour que cette proposition puisse être efficace, et pour qu’elle soit acceptée par le Congrès, encore fallait-il trouver la parade à l’exode fiscal qui en découlerait nécessairement. Aussi, le gouvernement américain envisage un impôt plancher international de 21 % sur les profits de toutes les entreprises. Fortement inspirée des travaux de l’économiste français, Thomas Piketty, et soutenue activement par la FED auprès de l’OCDE, l’idée d’instaurer un impôt plancher international demeure, en théorie, la solution la plus efficace pour lutter contre les paradis fiscaux. Une aubaine pour les États-Unis qui pourrait assister à la relocalisation d’une bonne partie des revenus et des activités de ses multinationales. Avec une harmonisation fiscale internationale, ce ne sera plus le niveau d’imposition qui dictera l’implantation d’une entreprise sur un territoire, mais bien l’activité, les infrastructures et la productivité potentielle. Encore faut-il que cette mesure remporte l’adhésion générale, notamment celle des pays ayant construit toute leur stratégie de développement sur un système fiscal ultra-compétitif.
La fin de l’hégémonie du marché ?

Le marché est au cœur de la construction de la doctrine néolibérale, la question autour de laquelle s’articulent toutes les autres. « Le néolibéralisme remet le marché au centre du fonctionnement de la société comme l’institution la plus juste, mais il garantit le fonctionnement de ce marché par la puissance publique » nous expliquait à ce propos Romaric Godin lors d’une précédente interview. Le retour des États, observé dans la plupart des pays du monde pour palier les conséquences de la crise du coronavirus n’est donc pas le signe suffisant d’un changement de stratégie ; bien au contraire, c’est là une réaction élémentaire qui été attendue. Quand le marché dysfonctionne, c’est bien l’État qui se porte à son chevet, le plus souvent en réglant la facture.
L’économiste David Cayla, auteur du livre Populisme et Néolibéralisme, nous expliquait d’ailleurs à ce sujet : « Toute la pensée néolibérale repose sur la conviction que le marché n’est pas une institution naturelle capable de s’autoréguler. C’est pour cette raison que l’intervention de l’État est indispensable. Mais cette intervention doit se faire sans dénaturer les mécanismes du marché. Au contraire, il faut accompagner le marché dans sa fonction de régulation et d’organisation de l’économie et de la société« . Au-delà des sommes mobilisées donc, c’est surtout la manière dont cet argent est utilisé qui indique une rupture avec la théorie économique dominante.
Si la plupart des plans de relance à travers le globe se contentent de subventions et de baisses d’impôts, dans la plus pure inspiration néolibérale d’une stimulation de l’offre, celui de Joe Biden mise sur un investissement direct dans l’économie. Ce n’est plus au marché de pourvoir aux besoins des citoyens, avec l’appui d’interventions étatiques à la marge pour créer des incitations, mais bel et bien l’État qui, par ses investissements, tend à devenir l’entité qui comble les besoins.
C’est ainsi que l’État fédéral va prendre directement en charge l’investissement dans des secteurs entiers, laissés en état de délabrement par la sphère privée. Par exemple, 115 milliards de dollars vont être mobilisés pour la reconstruction des routes et des ponts, 80 milliards dans les chemins de fer, 66 milliards dans les systèmes d’eau. Un effort important est également prévu dans l’éducation et les énergies vertes, afin de développer la productivité américaine, dans les infrastructures comme dans la main-d’œuvre. C’est donc un renversement de logique total. On cherche à ce que les investissements publics finissent par créer des investissements privés ultérieurs par une dynamique économique vigoureuse et un retour de la croissance.
La fin du néolibéralisme signe-t-il la fin des problèmes ?
Les problèmes écologiques et sociaux ont clairement été amplifiés ces dernières années par le développement du néolibéralisme. En offrant au secteur privé la maîtrise de la marche économique, les États ont laissé les intérêts individuels se déployer librement sans considération pour le bien commun. De ce fait, la fin du néolibéralisme serait une bonne chose pour tout le monde. Néanmoins, il serait naïf de se réjouir trop vite.
« Toujours séduisant quand il se sent menacé, le capitalisme a longtemps su se réinventer pour subsister dans le temps »
Tout d’abord, l’ampleur du plan est à relativiser. Les sommes mobilisées impressionnent mais elles sont loin de permettre une transformation en profondeur de l’économie américaine et donc de renverser totalement les tendances qui étaient en cours. Dans une tribune publiée dans les colonnes du journal Le Monde, les économistes Thomas Belaich et Eric Monnet rappelait que le New-Deal de Roosevelt représentait près de 50 % du PIB américain, investi sur sept ans, soit une moyenne d’investissement de l’ordre de 6 % du PIB par année. Le plan d’investissement de Joe Biden est bien moindre, de l’ordre de 11 %, investi sur huit ans, soit 1,4 % du PIB par an. On est donc davantage dans l’amorce d’une prise de conscience que dans une véritable révolution économique.
C’est la raison pour laquelle, l’aile gauche du parti démocrate estime que ce plan, bien qu’encourageant, n’est pas à la hauteur des enjeux contemporains, notamment concernant la problématique environnementale. Ce qui fait dire à la sénatrice, Alexandria Ocasio-Cortez, au micro de MSNBC : « J’ai de sérieux doute que [ce plan d’investissement] suffise à réaliser les objectifs que Joe Biden a avancés ». Au-delà des effets d’annonce, la question écologique demeure marginale dans la stratégie de Joe Biden. Toute la bonne volonté du monde, sans moyens suffisants, ne suffira pas à réaliser la transition écologique nécessaire.
Ce retour à un système proche de la social-démocratie du XXe siècle est-il possible aujourd’hui ? On peut en douter. En douter, car il est fortement envisageable que le capital, pour conserver ses marges, fasse peser les effets des hausses d’impôt directement sur les revenus du travail. La social-démocratie a parfaitement fonctionné à une époque de croissance exceptionnelle, où la rentabilité du capital était importante. On peut douter qu’il en soit de même aujourd’hui.

Par ailleurs, est-il pertinent de s’appuyer sur un modèle construit au siècle dernier, à une époque où l’on ignorait à peu près tout des questions environnementales ? Si la nouvelle stratégie de Joe Biden tourne le dos au néolibéralisme, les rouages classiques du capitalisme conservent toutes ses faveurs : culte de la croissance, consommation à outrance, finance, productivité. En convoquant la période la plus aboutie de son histoire, celle de la social-démocratie, de la redistribution forte, du confort de vie et du progrès social, c’est tout un mode de production qui, finalement, se légitime et vise sa perpétuation. Un mode de production qui, au file des contradictions qui font surface entre les intérêts du capital et la défense du vivant, craint pour la continuité de son hégémonie. Toujours séduisant quand il se sent menacé, le capitalisme a longtemps su se réinventer pour subsister dans le temps. Ce renouvellement de doctrine ressemble à l’ultime soubresaut d’un système à l’agonie, sentant poindre à l’horizon sa défaite inéluctable.
-T.B.
Pour aller plus loin sur le néolibéralisme
– Populisme et néolibéralisme, les deux faces d’une même pièce. Entretien avec David Cayla
– La guerre sociale est le résultat du développement du néolibéralisme. Entretien avec Romaric Godin
Nos travaux sont gratuits et indépendants grâce à vous. Afin de perpétuer ce travail, soutenez-nous aujourd’hui par un simple thé 😉☕