Écrivain et professeur de philosophie, Léonor Franc nous a confié un véritable condensé de réflexions sur les rouages profonds de notre condition politique ambiguë. En effet : la fuite de la démocratie que nous sentons s’accélérer en ce moment est-elle réelle ? Et si oui, pourquoi la vie semble-t-elle continuer comme si nous y étions toujours ? Dossier (1/2).
Entre fierté et désillusion, acquis historiques et vérités du présent, stratégies politiciennes et révoltes populaires : où en sommes-nous vraiment – au-delà des évidences et des raccourcis – de notre démocratie ? Premier volet d’un dossier philosophique en deux parties, proposé par Léonor Franc.
Le recul ou l’illusion de la démocratie ?

La Pologne, la Hongrie, l’Autriche, la Suède et désormais l’Italie : la montée en puissance de tendances politiques autoritaires semble ronger les démocraties européennes. C’est du moins la première analyse qui vient à l’esprit. Parmi les projets de la Hongrie ? La mise en place d’un État « fort », ultra-sécuritaire voire policier, un État où, dès lors, les citoyens sont davantage surveillés par le pouvoir que participant à celui-ci : voilà bien une mesure anti-démocratique. Le plan polonais ? L’installation d’un pouvoir exécutif qui rencontrerait des contre-pouvoirs limités, jusqu’à menacer même le principe d’État de droit. Et que dire de notre gouvernement ? Sa volonté acharnée de mener des politiques économiques néolibérales au service d’un renforcement des inégalités, voilà encore une atteinte criante au projet démocratique.
pour que la démocratie, française par exemple, soit dite « menacée », encore faudrait-il qu’elle existe.
Mais l’analyse est encore plus sombre dès que nous ne détournons plus le regard d’une remarque essentielle : pour que la démocratie, française par exemple, soit dite « menacée », encore faudrait-il qu’elle existe. Pour que nous parlions d’un recul de la démocratie, encore faudrait-il qu’elle fût un temps opérante. Or ce n’est pas le cas. Évitons de nous leurrer sur l’identification de la cause et de l’effet : à proprement parler, ce ne sont pas seulement les régimes autoritaires qui viennent fragiliser la démocratie, mais aussi, et peut-être surtout, l’absence de démocratie qui rend possible l’avènement de régimes à tendance autoritaire. Ainsi, au sujet de la Pologne par exemple, il faut dire que la démocratie n’a pas existé et que plus d’efforts seront désormais produits pour qu’elle ne naisse pas. Mais l’enquête qui suit englobe tous les pays actuels dits démocratiques, quand bien même les différences de degré ne sont pas négligeables et que le système politique suisse, par exemple, est moins éloigné de la démocratie que celui de la France. Afin de comprendre pourquoi nous faisons semblant de vivre en démocratie, il faut notamment revenir sur le fonctionnement véritable d’une démocratie et sur les objections, parfois grossières, parfois très subtiles, faites à ce régime. Je m’apprêtais donc à écrire : « Ce que je propose ici est un guide de défense de la démocratie. » Et cet effort ne serait pas anodin tant la démocratie est fragilement justifiée par nos contemporains. Mais en fait je souhaiterais que cet article soit aussi une arme de conquête pour faire naître ce qui n’est jamais advenu.
La non-démocratie française : responsabilité du système politique, responsabilité du peuple

Pour trouver des preuves que le système politique français actuel n’est pas démocratique, on a l’embarras du choix. Il y a des traits spécifiques de notre système qui sont répertoriables : la non-reconnaissance du vote blanc ; l’absence de scrutin proportionnel plurinominal aux élections législatives ; la possibilité pour l’exécutif, par l’article 49-3 de la Constitution, d’imposer une loi sans vote des députés ; l’impossibilité pour les citoyens de demander directement un référendum. Ainsi, rien n’est plus simple que de trouver des lois instaurées en France alors qu’elles allaient à l’encontre de l’avis de la majorité des citoyens. Il suffit de porter le regard sur deux des plus récentes décisions politiques. En janvier 2023, le gouvernement a refusé d’interdire la chasse le dimanche. Près de 8 Français sur 10 y étaient pourtant favorables (Ifop). Dans les mois qui suivent, le gouvernement, par le 49-3, impose une nouvelle réforme des retraites. 68% des Français y sont pourtant hostiles (Ifop). Ces faits sont d’autant plus frappants que les opinions correspondantes sont, chez les Français, stables dans le temps, donc visiblement réfléchies : elles ne relèvent pas de souhaits impulsifs et sont transpartisanes. À l’issue de ce constat, je laisse le soin à d’autres de trouver le mot juste pour qualifier notre régime politique actuel, subtil mélange, entre autres, d’oligarchie, de ploutocratie, de bureaucratie et de technocratie, le tout emballé dans un ensemble de gestes démocratiques indirects et formels qui revêtent, comme je l’évoquerai plus loin, un caractère de spectacle.
Toutefois, la balle de la responsabilité peut toujours être renvoyée dans l’autre camp. Nombreuses sont les publications qui critiquent les gouvernements successifs pour leur absence de volonté réelle de démocratie. Rares sont celles qui rappellent qu’un peuple a les dirigeants qu’il mérite. Si la démocratie n’advient pas en France, c’est aussi parce qu’une majorité de Français ne la choisissent pas, ou ignorent qu’elle n’est pas en place. Ils peuvent aussi y être favorables mais de manière velléitaire voire résignée, ou pire, être purement et simplement indifférents à sa possibilité. Les observations qui vont dans ce sens sont sans appel. Selon une étude Ifop datant de 2018, 59% des Français sont d’accord avec l’opinion suivante : « La France doit se réformer en profondeur, pour éviter le déclin, mais aucun homme politique élu au suffrage universel ne disposera plus du pouvoir nécessaire pour mener à bien ces réformes et, dans ce cadre, il faudrait que la direction du pays soit confiée à des experts non élus qui réaliseraient ces réformes nécessaires mais impopulaires » – je souligne. Pour les 18-24 ans, ce taux monte à 70%. Toujours parmi cette tranche d’âge, 49% vont jusqu’à soutenir qu’« il faudrait que la direction du pays soit confiée à un pouvoir politique autoritaire, quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s’exerçant sur le gouvernement ».
Le sentiment d’une liberté qui s’obtiendrait dans l’action avec autrui est presque toujours absent. Le désir politique ne se manifeste pas.
À l’échelle des lycéens, ces chiffres trouvent bien leur expression plus ou moins directe. Chaque année, j’interroge les élèves sur l’endroit où ils se sentent le plus libres, et ils répondent un par un. Les mots qui résonnent sont presque toujours : « Chez moi ». En demandant des précisions, le propos s’individualise encore plus : « Chez moi, dans ma chambre ». Lorsque, quelquefois, la réponse quitte le domicile privé, il est fréquent qu’il s’agisse d’une activité solitaire – « Je me sens libre lorsque je marche seul en forêt », par exemple. Le sentiment d’une liberté qui s’obtiendrait dans l’action avec autrui est presque toujours absent. Le désir politique ne se manifeste pas. Ils peuvent suivre et commenter l’actualité politique mais la tendance générale est qu’ils en restent les spectateurs. Enfin, même lorsqu’un élève se présente à l’élection des délégués de classe (donc souhaite accomplir une mission d’intérêt collectif), il n’est pas rare qu’il avoue que ce titre ferait bonne impression dans son dossier. Cette absence de désir politique vrai s’inscrit évidemment plus largement dans la crise contemporaine du lien social, analysée par les sociologues depuis plusieurs décennies – par Zygmunt Bauman notamment.
Usons d’un dernier exemple. Le 16 février 2023, la cinquième journée de manifestations contre la réforme des retraites est bien moins suivie que les précédentes. La raison ? Les vacances scolaires dans une zone de la France. Le fait est si habituel que nous ne nous en étonnons même plus. Les Français qui sont en congé et hostiles à la réforme pourraient manifester sans perdre une journée de salaire : la défense de leurs droits devient gratuite et accessible. La mobilisation devrait donc s’accroître. L’exact inverse est observé. La priorité des Français est claire : le temps libre sera d’abord consacré à la jouissance privée. D’où la question : comment est-il possible qu’un peuple ayant mené trois révolutions il y a moins de trois cent ans puisse penser aujourd’hui : la piscine avant les droits sociaux ?
La servitude volontaire

On pourrait répliquer que ce sont les classes dirigeantes qui s’assurent que ce désir de démocratie ne naisse pas chez le peuple, ainsi le peuple ne serait pas coupable dans cette affaire mais simplement manipulé. Suite à quoi on pourrait toutefois renchérir : le peuple est responsable d’avoir mis au pouvoir des gens qui manipulent le peuple – et ainsi de suite à l’infini. Les deux versants de l’explication doivent être explorés et nous devons à La Boétie d’avoir très clairement écrit sur l’un d’entre eux. La question principale de La Boétie était celle-ci : d’où vient le pouvoir politique ? Sa réponse : il vient du peuple, toujours. Qu’est-ce que le peuple ? La totalité des membres de l’État.
Prenons en effet les deux cas de figure possibles : d’abord, tautologiquement, la situation où la totalité des membres de l’État sont dirigeants et où le pouvoir politique provient alors explicitement du peuple ; ensuite, la situation où il y a des individus dirigeants et des individus seulement dirigés. Ici, La Boétie montre que ces derniers sont, en vérité, inévitablement dirigeants également. Qu’on y réfléchisse à travers un cas particulier : 86% des Français se déclarent favorables à la reconnaissance du vote blanc (Ifop, 2017) mais la loi n’a pas encore changé en ce sens. Sont-ils seulement victimes des décisions de « ceux qui ont du pouvoir, là-haut » ? Sont-ils dépossédés de leur pouvoir de changement pour plus de démocratie ? La Boétie répondrait que, si ces 86% cessaient de travailler ne serait-ce que deux jours et dans la plupart des corps de métier, le pays s’en trouverait totalement paralysé et les dirigeants devraient immédiatement satisfaire la revendication. Ce mouvement à la force colossale pourrait, de même, exiger et obtenir une compensation financière immédiate pour les deux jours de salaire perdus. Il l’exige et il l’obtient parce qu’il se rend compte qu’il est le pouvoir : il s’accorde donc des droits par lui-même.
Pour La Boétie, il est donc faux que le pouvoir des Français est bloqué. La Boétie dirait plutôt, en première analyse : ils ont un pouvoir qu’ils n’utilisent pas. Puis, plus précisément : ils ont un pouvoir qu’ils utilisent mais dans un sens contraire à leur propre intérêt. Ce pouvoir réside dans leur obéissance qui vient soutenir le système politique en place. Ils dirigent à travers leur passivité qui est toujours aussi, en vérité, une complicité. D’où le paradoxe de la servitude volontaire : si le peuple est tyrannisé, il est complice de sa propre tyrannie. Pour qu’il se libère, il suffirait qu’il n’obéisse plus.
« Je ne veux pas que vous heurtiez le tyran, écrit La Boétie, ni que vous l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. »
– La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Magnard, 2021, p. 21.
Finalement, dans tous les cas, le peuple dirige – soit par son activité, soit par sa soumission. De ce point de vue, nous pourrions dire que tous les régimes politiques qui existent sont démocratiques – occasion de rappeler que la politique est, par essence, l’affaire publique, le système social où toute décision a le peuple pour origine et fondement. Mais j’appelle ici démocratie le régime politique où le peuple a pleinement conscience qu’il détient le pouvoir et qu’il l’exerce alors de manière active et réfléchie. Comme l’avait compris Hegel, pourtant loin d’être partisan de la démocratie directe : l’avènement de la démocratie est parallèle à l’avènement de la conscience de soi. Tout problème politique est aussi un problème psychopolitique : un peuple qui s’éloigne de la démocratie est un peuple qui tient à éviter d’avoir conscience de sa propre condition. D’où l’impossibilité d’avoir un régime démocratique chez un peuple qui ne philosophe pas. D’où aussi, peut-être, le surgissement d’une étincelle démocratique en Grèce antique, berceau de la philosophie occidentale.
L’absence d’espace public

Le refus de la démocratie véritable en France se révèle de manière particulièrement flagrante dans l’absence de débat. Le débat est, à de nombreux égards, le cœur même d’une démocratie. Le lieu où les points de vue divergents se rencontrent et s’articulent constitue cet espace public entendu comme agora. Évidemment, des débats ont bien lieu sur certains plateaux de télévision et de radio, au Parlement et dans la sphère familiale. Mais cela ne constitue en aucun cas une agora ni ne relève de l’exercice d’une démocratie, puisque chacun de ces espaces est travaillé par l’exclusion : exclusion de ceux qui ne sont pas présents sur le plateau médiatique, exclusion de ceux qui ne sont pas parlementaires, exclusion des autres familles. Certes, un débat ne peut pas se dérouler dans des conditions convenables en ayant un nombre trop élevé de participants. Qu’est-ce que j’entends par le terme critique d’exclusion, alors ? Je pointe ici du doigt le caractère systématique et orienté de cette exclusion : renouvellement très faible des débatteurs médiatisés et des parlementaires, sélection des intervenants sur des critères rigides voire illégitimes comme l’appartenance à une classe socio-économique, extrême rareté des débats entre plusieurs familles.
L’avènement d’Internet pourrait changer la donne. Toutefois, la plus grande partie du monde virtuel, tel qu’il est conçu aujourd’hui, est plus souvent un lieu de communication que de débat. Il est un lieu de juxtaposition de bulles de pensée seulement avides de confirmation de leurs opinions, et nous connaissons la cause de cela : l’intensive marchandisation de ces réseaux dont les profits reposent sur le principe de personnalisation des informations, tel qu’exposé dans le documentaire The Social Dilemma. Voir un ensemble personnalisé d’informations, préparé sur mesure, est précisément l’inverse de la rencontre d’autrui dans un espace public. Ainsi, des réseaux comme Facebook, YouTube ou Twitter ne forment pas un espace public, cet espace dont la disparition progressive inquiétait déjà Arendt. Un espace public est un espace où l’on rencontre des opinions diverses et parfois adverses, un espace où tout n’est pas fait pour notre confort mais où l’on rencontre parfois ce qui gêne, avec souvent l’impossibilité d’éviter la conversation – et cela nous aide alors à penser contre nous-mêmes, soit la force critique qui rend une réflexion constructive.
Dans un échange de commentaires sur YouTube par exemple, que se passe-t-il ? Premièrement, l’interlocuteur peut partir à tout moment, en un clic – il n’y a aucune obligation d’écoute. Deuxièmement, il peut supprimer son commentaire, ne laissant par là aucune trace – YouTube, à proprement parler, n’a donc pas d’histoire. Troisièmement, entre le moment où l’utilisateur s’exprime et le moment où il reçoit une réponse, il y a un délai – autrement dit, il obtiendra sa réponse quand il aura le dos tourné, quand il sera seul. Les messages échangés sont davantage des actions isolées, à distance, qu’une interaction. Quatrièmement, la vidéo qu’il commente lui est suggérée sur la base d’un algorithme qui sélectionne ce à quoi il aime déjà réagir. Ces quatre caractéristiques mettent à mal la naissance de tout contexte contraignant de la discussion propre à modifier et affiner une opinion. Elles œuvrent plutôt à la formation d’une bulle confirmationniste qui représente, comme Karl Popper l’a montré, l’échec de la rationalité.
La finalité de cette tendance ne peut être que de faire advenir « un État où chaque homme ne pense que ses propres pensées ». Cet État, Arendt lui donne un nom : « la tyrannie » (1). Cet énoncé a de quoi choquer l’esprit contemporain. Aujourd’hui, nous estimons souvent qu’autrui, au contraire, entrave notre processus de pensée. Autrui est l’obstacle avant d’être le partenaire. Le fait de « penser sa propre pensée », situation tyrannique lorsqu’elle est généralisée, paraît immédiatement louable. Car penser de manière isolée serait penser par soi-même. À l’inverse, celui qui pense à travers la parole d’autrui serait forcément dépendant et conformiste. Pourtant, penser avec ou contre autrui n’est évidemment pas synonyme de penser comme autrui. Dans l’espace public, nous pouvons exercer librement notre pensée (nous n’obéissons à personne) tout en confrontant nos pensées avec celles des autres. Le fait que la présence d’autrui soit nécessaire pour penser librement n’implique aucunement que cette présence soit suffisante pour que nous pensions – situation du conformisme.
La politique vue comme moyen de se libérer de la politique
« N’est-il pas vrai que nous croyons tous d’une manière ou d’une autre que la politique n’est compatible avec la liberté que parce et pour autant qu’elle garantit une possibilité de se libérer de la politique ? »
Puisque nous croyons que la liberté s’obtient d’abord dans la sphère privée, il est inévitable que nous souhaitions nous débarrasser de la politique. « N’est-il pas vrai que nous croyons tous d’une manière ou d’une autre que la politique n’est compatible avec la liberté que parce et pour autant qu’elle garantit une possibilité de se libérer de la politique ? », demande rhétoriquement Arendt (2). Dans ce cadre psychopolitique, il devient nécessaire d’élire des représentants, c’est-à-dire des individus qui s’occuperont du fardeau de la politique à notre place. La politique sera le moyen, et la fin, notre piscine. Encore faudra-t-il s’assurer que les dirigeants garantissent bien cette jouissance privée. Toutefois, commencer à les surveiller, c’est commencer à perdre notre temps, c’est-à-dire à faire de la politique. L’idéal est donc plutôt de bien choisir les représentants puis de leur faire confiance. Ainsi nous voyons peu à peu s’opérer le glissement de la démocratie représentative vers la tyrannie. Car la démocratie n’est pas une affaire de confiance : elle est plutôt, comme l’énonce justement Edward Snowden, une exigence d’effort (3). C’est ici l’occasion de préciser que l’espace public n’existe pas avant qu’il soit investi. L’espace public n’est rien d’autre que l’acte d’investir cet espace. Il ne peut pas se contenter d’exprimer une possibilité ou une attente d’action politique. Il est une scène qui disparaît lorsque l’acteur la quitte.
Notre « liberté politique » consiste donc, paradoxalement, à s’offrir la liberté d’échapper à la politique. Par là, cette liberté vient, certes, nous distinguer du totalitarisme. Nous évitons, pour parler comme Benjamin Constant, « l’assujettissement complet de l’individu à l’autorité de l’ensemble » (4), ce sacrifice de la totalité de notre liberté individuelle à la politique. Mais cette conception de la liberté politique nous éloigne aussi nettement de la démocratie. Notre liberté politique actuelle admet principalement trois failles.
D’abord, elle place au centre de sa fierté le droit de vote. Toutefois, ces moments de vote sont rares : nous sommes tels les Anglais décrits par Rousseau, libres quand ils élisent les membres de leur Parlement, esclaves le reste du temps, c’est-à-dire presque toujours. À vrai dire, même au moment où nous votons, notre statut d’esclave est conservé, ce vote n’ayant rien de démocratique, d’une part car il n’est pas le résultat d’un débat citoyen, d’autre part car nous votons habituellement pour des représentants, pas pour des lois – et des représentants qui ne vont pas se contenter d’appliquer des lois que nous proposerions, mais qui voleront notre pouvoir de législation.
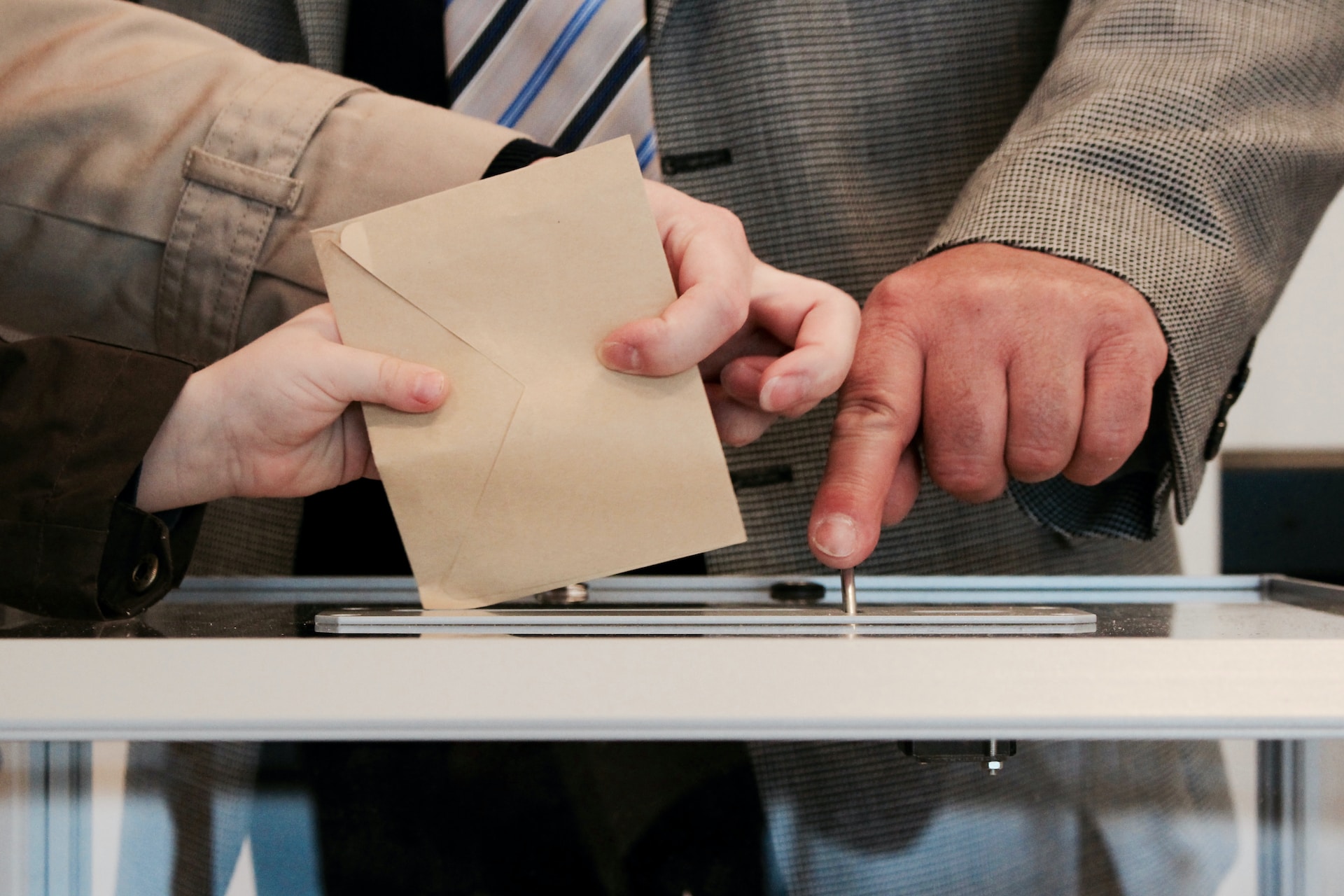
Le deuxième point émerge du constat que même ce droit de vote est peu utilisé. Visiblement, il nous suffit que ce droit soit possible pour être sereins. De manière générale, nous concevons la liberté politique comme possibilité de liberté politique. Nous ne vivons pas en dictature car nous pourrions aller voter, nous pourrions nous présenter aux élections, nous pourrions créer notre propre syndicat, etc. Et nous nous contentons du possible. Mais, si nous faisions l’effort d’actualiser ce possible, nous constaterions souvent à quel point ce possible est en vérité un chemin semé d’embûches – idée que je développe ailleurs (5). De plus, encore une fois, seule l’action régulière fait vivre une démocratie. Dans une démocratie, il ne peut pas suffire que l’individu se dise : « Je serai un acteur politique au cas où les décisions des autres me déçoivent. »
Ce qui mène au troisième point : nous concevons la liberté politique non pas comme un faire mais comme une absence d’interdiction de faire. Pour l’individu moderne, l’important n’est pas de voter. L’important est qu’il ne lui soit pas interdit de voter. Il ne se rend pas compte (ou ne veut pas se rendre compte) que des libertés non utilisées ne sont pas des libertés, que la liberté est indissociable de sa mise en acte. En outre, puisque nous avons horreur de l’interdiction, nous percevons de plus en plus les lois comme des contraintes, alors même qu’elles peuvent exprimer un juste rapport à autrui. C’est ainsi que, pour 46% des Français, payer ses impôts n’est pas un acte citoyen (Ipsos pour Le Monde, 2018).
Comment une démocratie véritable fonctionnerait-elle ?
Pour critiquer l’absence de démocratie, encore faut-il avoir une idée de ce que sa présence signifierait exactement.
Il y a d’abord les deux principes essentiels d’une démocratie directe, lesquels ne sont donc pas négociables. D’une part, il s’agit bien sûr de permettre au peuple de participer à la vie politique le plus régulièrement possible et que ce peuple soit souverain, c’est-à-dire refuser toute délégation de la volonté du peuple. D’autre part, donner le pouvoir à un peuple qui serait maintenu dans l’ignorance serait, évidemment, totalement suicidaire. Ainsi, comme le notait Proudhon : « Démocratie c’est démopédie, éducation du peuple ».

Pour que les décisions du peuple soient les plus rationnelles possibles, l’éducation nationale doit être forte. Nécessairement, cette éducation doit être gratuite, obligatoire et préparer à l’exercice de la démocratie en insistant sur l’approche sociale de la raison et le développement de l’esprit critique. Par la construction d’une éducation nationale forte, nous entendons aussi l’application de mesures égalitaires pour construire les fondations de l’isonomie propre au futur citoyen d’une démocratie. Il y a tout un ensemble de mesures évidentes pour une telle école égalitaire : financer davantage l’école publique que l’école privée ; réduire le temps des vacances d’été durant lesquelles, comme il est prouvé (6), les inégalités scolaires se (re)creusent considérablement ; réduire le nombre d’élèves par classe pour un accompagnement de meilleure qualité, etc.
Ensuite, l’application concrète d’une démocratie directe est évidemment plus complexe. Il fut un temps où elle était même impossible pour tout pays trop vaste. Comment se réunir et voter régulièrement à grande échelle ? Aujourd’hui, avec l’avènement d’Internet, il n’a jamais été aussi simple de se réunir massivement et régulièrement pour débattre (grâce à un réseau qui échapperait aux défauts mentionnés plus haut) ou du moins pour voter. L’histoire retiendra que, paradoxalement, l’apparition de cette possibilité a été contemporaine d’un virage autoritaire de nos régimes.
Des référendums pourraient être organisés chaque semaine sur un Internet sécurisé. Entrer dans les détails du reste du fonctionnement d’une démocratie n’est pas le but du propos ici et, de toute manière, ferait l’objet d’un débat démocratique lui-même. Il est au moins certain que les votes doivent être précédés de débats entre citoyens. Pour que chaque point de vue ait le temps de s’exprimer et d’être entendu, les débats comporteraient un nombre restreint de citoyens, avec une alternance des membres de chaque groupe. De plus, il y aurait des débats à différentes échelles afin d’évaluer de près les préoccupations locales.
Mais n’y a-t-il pas des situations locales dont les enjeux sont nationaux ? Et comment seraient choisis les sujets sur lesquels le peuple débattrait et les différentes options de vote ? Faut-il qu’une partie de la population s’occupe des affaires intérieures, une autre des affaires extérieures, et ainsi de suite pour tous les grands domaines de la politique, et faut-il s’assurer qu’il y ait un remplacement périodique de ces catégories citoyennes pour éviter toute spécialisation excessive ? Et à quelle fréquence les participants de chaque groupe doivent-ils être renouvelés ? Et renouvelés au hasard ? Tout cela doit être discuté, puis pratiqué et amélioré par essais et erreurs. Par ailleurs, il est probable que le plus prudent soit d’atteindre progressivement la démocratie directe en passant par une démocratie semi-directe similaire à la Suisse, ce qui constituerait déjà une grande avancée. Enfin, si le peuple a encore des représentants de sa volonté, il s’agit d’éduquer celui-ci de sorte que naisse en lui le désir d’utiliser et de demander régulièrement des contre-pouvoirs pour surveiller ces dirigeants… Jusqu’à ce que ces « contre-pouvoirs » soient si grands qu’ils constituent en fait le pouvoir lui-même et marquent le passage à une démocratie nettement directe.
Pour finir sur ce point, il convient d’insister une seconde fois sur le fait que seuls les principes de démocratie directe et d’éducation nationale forte sont essentiels. Toutes les autres propositions sont des objets de débat et continuellement modifiables. Voici deux exemples qui en étonneront peut-être certains : la démocratie n’implique pas forcément le partage collectif de toutes les choses. Ce communisme n’est qu’un choix possible parmi d’autres que peut faire le peuple. Deuxième exemple provenant du premier : les travailleurs devront-ils tous posséder des parts de leur entreprise ? Cela fait aussi l’objet d’un débat démocratique à toutes les échelles de l’État. Toutefois, premièrement, si un travailleur possède plus de parts de l’entreprise que les autres, alors cette différence doit être débattue, approuvée par l’ensemble des travailleurs et constamment révocable. Deuxièmement, il faut reconnaître qu’il est probable que, si chaque travailleur a une part égale ou à peu près égale de son entreprise, alors la conscience du fait politique s’en trouve encouragée et le processus démocratique stimulé.
…Brèves réponses aux objections classiques à la démocratie ; Les religions sont-elles compatibles avec la démocratie ? ; Les forces qui maintiennent l’apparence démocratique française ; …. À suivre dans le second volet de ce dossier consacré à la (non)démocratie.
Sources :
(1) Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1991, p. 213
(2) Ibid., p. 194
(3) Propos tiré du documentaire Meeting Snowden par Flore Vasseur (Arte, 2017)
(4) Benjamin Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », in Écrits politiques, Paris, Gallimard, « Folio essai », 1997, p. 594
(5) Écrits pour les rares personnes qui tentent d’exister, Paris, Editions Skhedia, 2022, p. 296
(6) Alexander, Entwisle et Olson (2007), « Lasting Consequences of the Summer Learning Gap », American Sociological Review, Washington, DC
Lire aussi sur le même thème :
- Sommes-nous en démocratie ? L’échec de notre système
- Démocratie en danger : la crise sanitaire n’est pas résolue
- Mondialisation néolibérale : ennemi de la démocratie ?
- Des alternatives à la démocratie représentative existent
- Crise de la communication : 16 clefs pour sauver la démocratie
Photo d’entête Affiches Le Pen-Macron, élection présidentielle 2017 @Lorie Shaull/Flickr

















