Dans son dernier livre, le prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz adresse une nouvelle charge sévère contre le néolibéralisme. Une analyse au vitriol qui séduira les lecteurs avides de comprendre des mécanismes économiques contemporains mais qui déçoit également par son manque d’audace. Explications.
Ancien membre de l’administration Clinton et vice-président de la Banque mondiale, Joseph E. Stiglitz jouit d’une aura importante dans l’univers économique dont il connaît parfaitement les rouages. Une aura renforcée par l’obtention, en 2001, du Prix honorifique de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel (qualifié à tort de Prix Nobel d’économie) pour son analyse de l’instabilité des marchés financiers. Avec Peuple, Pouvoir & Profits, son dix-neuvième livre, publié avant la pandémie de Covid-19, l’auteur poursuit son analyse des failles du néolibéralisme et de ses conséquences néfastes pour la population américaine.
L’auteur ne se contente pas d’une simple analyse. Toute la seconde partie de l’ouvrage cherche à dessiner les contours d’un programme progressiste pour redresser la situation économique américaine. Un programme qui donne une place centrale à l’État, réhabilitant son rôle de stratège économique dans l’intérêt du plus grand nombre.
Une initiative prescriptive, concrète, suffisamment rare pour être soulignée, tant les intellectuels ont tendance au mutisme quand il s’agit de donner une orientation à suivre.
Un secteur privé à la dérive et une concurrence de façade
L’auteur critique vivement le secteur privé qui ne sert, selon lui, que ses intérêts propres au détriment de la santé économique mondiale. A l’instar d’Adam Smith, le père du néolibéralisme : « il est rare que les gens du même métier se trouvent réunis […] sans que la conversation finisse par quelques conspirations contre le public ou par quelques machinations pour faire hausser les prix » Stiglitz explique que, loin de vivre dans une économie où règne une saine concurrence, les grandes compagnies cherchent à imposer, de concert, leurs intérêts. Le résultat : les marchés tendent à devenir de plus en plus monopolistiques.
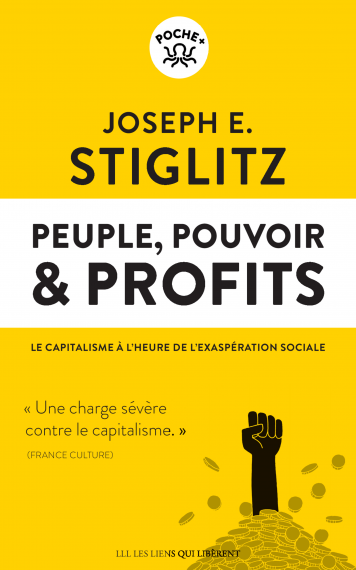 En effet, bien que le néolibéralisme ait fait de la concurrence libre et non-faussée la pierre angulaire de toute sa structure théorique, la réalité économique montre, au contraire, que bon nombre de grandes entreprises jouissent d’un pouvoir de marché leur permettant de dicter les règles qui les arrangent pour réaliser des profits colossaux.
En effet, bien que le néolibéralisme ait fait de la concurrence libre et non-faussée la pierre angulaire de toute sa structure théorique, la réalité économique montre, au contraire, que bon nombre de grandes entreprises jouissent d’un pouvoir de marché leur permettant de dicter les règles qui les arrangent pour réaliser des profits colossaux.
C’est la raison pour laquelle les fusions-acquisitions se sont multipliées ces dernières années, permettant à deux entreprises d’un même marché de s’unir pour effacer toute concurrence et imposer leurs règles et leurs prix. Les sommes mobilisées pour ces opérations ont atteint un record en 2015 avec 4 700 milliards d’euros déboursés. Le cas de Facebook ayant déboursé 1 milliard de dollars en 2017 pour acquérir Instagram est emblématique. Il s’agit là d’une opération de fusion préventive afin d’éliminer un potentiel concurrent sur le marché de la diffusion de publicité numérique.
Avec ces opérations, les grandes compagnies n’ont plus à se livrer à une guerre de prix pour rafler la clientèle et asseoir leur monopole. Elles peuvent ensuite, en toute tranquillité, vendre leurs marchandises au prix fort afin de réaliser ce que Stiglitz qualifie de surprofit. C’est là un transfert de richesse direct qui se fait du consommateur, payant un produit au-dessus de sa valeur, vers les grandes entreprises. Une manœuvre qui aggrave les inégalités et enrichit les actionnaires au détriment des consommateurs.
Un manque de concurrence qui mine l’économie
Dans le même esprit, les très grandes compagnies s’entendent parfois entre-elles pour réaliser des accords de non-débauchage. L’idée ? Un salarié d’une grande compagnie ne peut travailler chez un concurrent sous peine de sanction pour sa nouvelle entreprise. Empêchant les employés de se vendre au plus offrant, les salaires sont mécaniquement tirés vers le bas tandis que les marges grimpent.
Une situation qui dégrade le pouvoir d’achat des ménages en plafonnant les salaires et en surfacturant des produits, mais qui mine également toute l’économie par effet domino. Une entreprise en situation de monopole rechignera davantage à investir concrètement dans ses infrastructures car rien ne la pousse à augmenter sa compétitivité. De même pour la recherche et l’innovation qui sont pourtant des secteurs clés pour dynamiser la croissance.
L’Etat, seul capable de corriger les failles du secteur privé.
Ainsi, la confiance religieuse dans le secteur privé a mené les Etats-Unis à cette situation : « une économie à horizon court et à croissance lente » explique Stiglitz.
Pour pallier ce processus, l’auteur en appelle à un rôle accru de l’Etat en utilisant le levier fiscal pour taxer les hauts revenus et les rentes afin d’investir dans ce qui contribue à bonifier la croissance : la recherche, l’éducation et l’innovation. Stiglitz critique également la démocratie américaine dévoyée par l’argent « nous vivons dans un système où un dollar égal une voix » et par un mode de scrutin qui ne représenterait pas réellement la volonté populaire. Une réforme de ce mode de scrutin présidentiel permettrait, à en croire l’auteur, d’amener au pouvoir des présidents plus représentatifs de la volonté populaire et donc plus soucieux des intérêts des citoyens.
Une vision en décalage avec les problématiques contemporaines.
Si quelques analyses restent intéressantes, le texte souffre d’un problème de redondance. En effet, les critiques adressées au néolibéralisme sentent le déjà-vu, et les solutions proposées pour y pallier semblent en-deçà de ce que la situation exige : un changement de modèle profond et radical. Ce sont les dérives du capitalisme qui sont montrées du doigt, non le capitalisme lui-même, encore moins le dogme de la croissance. Pourtant, les dérives dénoncées ne sont-elles pas inhérentes au principe même de ce modèle économique qui favorise la prédation, la compétition, la cupidité et l’individualisme ? Peut-on encore se contenter de demi-mesurettes alors que tout le système est malade ?
Ainsi, réformer le mode de scrutin suffira-t-il, à lui seul, à faire élire un candidat loyal envers le peuple, honnête envers la patrie ? On en doute. A lire Stiglitz, les baisses d’impôts et les orientations néolibérales ne seraient imputables qu’aux seuls présidents Républicains, Donald Trump et Ronald Regean en tête. C’est vite oublier les mandatures de Bill Clinton et Barak Obama qui ont, eux aussi, joué le jeux de la finance et de la mondialisation exacerbées.
Les collusions de classe sont l’une des raisons majeures qui explique cette politique injuste et favorable aux plus riches. Comme l’a montré le travail des Pinçont-Charlot, la bourgeoisie est une classe consciente de ses intérêts et possédant l’influence nécessaire pour les satisfaire. Trop souvent Stiglitz met sur le compte de l’erreur d’appréciation les conséquences néfastes de la politique économique de ces dernières années : « on s’est trop reposé sur nos lauriers » explique-t-il. Il y a pourtant une telle cohérence dans la marche du monde qu’il s’agit davantage d’une orientation choisie que d’une erreur de parcours. « Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner » disait Warren Buffet, troisième fortune mondiale. Des réformes décoratives suffiront-elles pour peser dans ce rapport de force disproportionné ? On aimerait y croire, mais définitivement pas.
» Ne serait-il pas plus pertinent d’expliquer que l’opulence bon marché d’hier sera illusoire demain ? «
Les enjeux environnementaux sont, quant à eux, complètement laissés de côté par Stiglitz qui ne leur accorde qu’une place très marginale dans son ouvrage. L’économie d’abord. Hormis l’idée d’une taxe carbone, déjà largement appliquée par ailleurs, rien de bien concret n’est proposé. L’auteur reste un farouche défenseur du libre-échange. Or, la perpétuelle circulation des marchandises à travers le globe a un impact sur le réchauffement climatique. Tout projet écologique un minimum sérieux commence par une relocalisation de la production, notamment agricole, avec des pratiques durables.
De plus, Stiglitz le répète comme un mantra tout au long de son texte, la population américaine cherche à retrouver « une vie de classe moyenne ». L’intérêt de la population n’est perçu qu’à travers le prisme de sa capacité à consommer. Si les préoccupations écologiques ne sont pas forcément la priorité première des travailleurs à la peine, des précaires et des chômeurs, est-ce réellement une solution que de leur promettre un retour au mode de vie du XXe siècle ? Ne serait-il pas plus pertinent d’expliquer que l’opulence bon marché d’hier sera illusoire demain ? Qu’il est nécessaire d’envisager une économie soutenable où l’on possède moins pour posséder mieux ?
Ainsi, l’ouvrage apporte quelques analyses intéressantes pour qui veut comprendre un peu mieux les raisons du chaos actuel, mais les solutions prescrites semblent naïves politiquement et la foi inébranlable dans le capitalisme qui habite chacune des pages tend à prouver que les vielles recettes ne nous sont plus d’aucun secours. Il est grand temps que les intellectuels se réinventent et surtout que les institutions songent à récompenser les esprits innovants en matière d’économie.
Peuple, pouvoir & profits, Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale, Joseph E. Stiglitz, 416 pages, Éditions Les Liens qui Libèrent.
ISBN : 979-10-209-0912-1.
– T.B.


















