Publié pour la première fois en 2015 dans sa version anglo-saxonne sous le titre de Drinking Molotov Cocktails With Gandhi, le livre de Mark Boyle a enfin été traduit dans la langue de Molière pour soumettre au public francophone une perspective injustement diabolisée : l’écologie radicale. Finie d’être une option, elle est devenue une urgence que nous devrons, tôt ou (trop) tard, considérer à sa juste valeur face au bulldozer profondément assassin qu’est notre modèle insatiable. « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » disait Gandhi. L’auteur le prend au mot. Le monde dont il rêve n’est pas apathique face à la destruction véritablement violente du vivant. Il est proactif, engagé, courageux. Révolté ? Aux célèbres « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler), Mark Boyle leur préfère de loin : Résister, se Rebeller, Réensauvager. Immersion dans ces réflexions inconfortables qu’il n’est plus temps de balayer sous le tapis.
S’il y avait deux livres à consulter pour s’immerger au cœur de ce qu’est véritablement l’écologie, – là où bouillonne l’authenticité de la vie qu’on avait perdue, où le paysage apparaît enfin lavé des fioritures aveuglantes du capitalisme-vert et débarrassé des discours factices du libéralisme, là où se montre enfin la réalité grotesque de notre système et tout ce qu’il gâche, tout ce qu’il tue, tout ce qu’il détruit sans permission, avec facilité et nonchalance – il pourrait sans doute s’agir de Pieds nus sur la Terre, une autobiographie de Rob Greenfield dont nous vous parlions récemment et de Boire des Cocktails Molotov avec Gandhi, de Mark Boyle.
En effet, à l’heure où nos convictions sont plus que jamais à fleur de peau et où nos croyances ne demandent qu’à être confortées dans des bulles informationnelles, Mark Boyle, également auteur de l’Homme sans argent – Le livre culte de la décroissance et de L’année Sauvage – Une vie sans technologie au rythme de la nature, ne craint nullement de bousculer les consciences, au-delà des conventions.
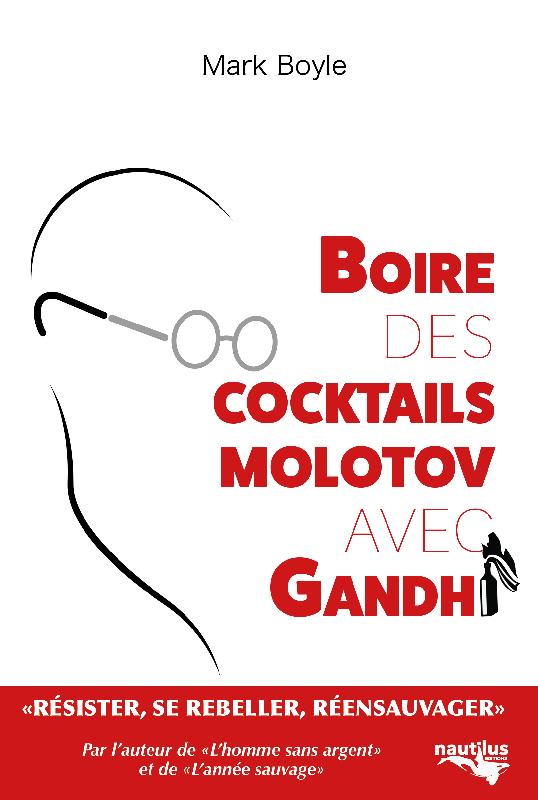
Discuter de violence, tabou ultime d’un monde pourtant ultra-violent
Dans sa dernière parution, face à la situation socio-environnementale critique, l’écrivain creuse la question décisive de la violence. De celle, officielle, qui se targue de légitimité pour faire oublier sa permissivité, à celle qu’on ne voit pas distinctement, industrielle, qui broie continuellement la vie sous nos nez occupés, en passant par celle, citoyenne et activiste, qu’on dramatise, fustige et instrumentalise, alors qu’elle ne compte de son côté aucun blessé.
Car preuve en est, de la centaine d’actions qualifiées d’ «éco-terrorisme» par le gouvernement américain sur les vingts dernières années, rappelle l’auteur, il n’y a jamais eu aucune victime – si ce n’est les millions de dieux-dollars immatériels avec lesquels jouent impunément de puissants actionnaires de qui nous, et l’écosystème Terre, sommes devenus les dévots sacrifices.
« Mais que le lecteur ne s’y trompe pas : ce livre n’est en aucun cas une ode à la violence. Surtout pas. Notre monde en est déjà rempli. Une quantité et un niveau de violence jamais enduré auparavant par la nature. Mon souhait n’est en aucun cas d’encourager qui que ce soit à en ajouter » précise l’auteur qui vit aujourd’hui dans une maison auto-construite en Irlande, coupé d’internet et de l’eau courante, par adhésion aux principes qu’il prône.

Appel ou non à prendre les armes, pour la maison d’édition, la traduction d’une vision aussi totale de l’activisme écologique n’a pas tout de suite été une évidence : « Les lecteurs étaient-ils prêts à réfléchir sur un tel sujet ? À s’interroger sur la définition de ce qu’est la « vraie violence » ? Celle utilisée quotidiennement dans l’indifférence quasi générale et qui détruit la vie ou celle opposée par quelques-uns pour préserver cette nature avec laquelle nous ne faisons qu’un ? Et, enfin, étions-nous tous prêts à revoir nos concepts de légitime défense quand la vie est menacée ? » expliquent Christophe et Lysiane Agnus-Rivière des éditions Nautilus.
Mais de leur avis, quel qu’aurait été l’accueil des lecteurs, ce texte était nécessaire. Impératif à vrai dire, parce qu’il était honnête, sourcé, paradoxalement mesuré et profondément vivant. Sans doute à l’inverse de notre société.
La violence invisible de la « Machine » est la pire de toutes

Au fil des pages, Mark Boyle développe en effet une pensée radicale qui paraît de moins en moins extrême à mesure qu’on la décortique. Sa première thèse ? La violence la plus féroce nous vient de ce qu’il appelle la Machine. Cette Machine moderne que l’on entretient, qui est d’une violence inouïe envers les êtres, et ce, sans même que l’on ne s’en rende compte, car la minorité qui en extirpe ses privilèges n’a pas intérêt à ce qu’on la perçoive au quotidien, à ce que notre capacité de consommation qui l’enrichit tant soit entachée.
La violence incommensurable de notre ère industrielle est invisible parce qu’elle se trouve en bout de chaîne d’un millier d’intermédiaires qui nous la rendent incertaine, donc irréelle. Loin des yeux, loin du cœur. Pourtant, elle est bien palpable : derrière chacun des moindres gestes qui nous garantissent un confort occidental, rendu indispensable dans notre époque contemporaine. Elle est là, et dévore la vie à un point qu’elle nous fait accepter le pari de notre propre destruction.
Océans vidés, terres étouffées, biodiversité épuisée et à l’agonie dans le bain de pollution chimique et atmosphérique de nos activités industrielles, forêts dévastées, inégalités creusées plongeant des vies entières dans une misère inéluctable, psychologique, physique et existentielle, exploitation de la chair, de nos os, du souffle vital : voilà ce que Mark Boyle désigne comme les « victimes de la suprématie humaine », du moins de son système vampirisant néo-colonial et capitaliste.

La Machine, c’est « la banalité du mal » d’Hannah Arendt appliquée à l’écocide. Cette mécanique qui consiste à morceler au maximum les différentes étapes d’un crime atroce que personne ne saurait individuellement s’en incriminer. Le maillage est idéal pour que perdure une société-usine dont l’énergie vitale dépend de la destruction du monde, sans que jamais notre empathie ne s’en trouve sollicitée, et encore moins alarmée.
« Nous devons commencer par être honnêtes envers nous-mêmes quant à la violence inhérente à la civilisation industrielle »
Voilà donc le premier principe que nous adresse Mark Boyle. Et voilà, peut-être, le plus gros du travail que nous, lecteurs, avons à produire avant d’espérer entendre la suite. Et il n’est pas si aisé, nous prévient l’écrivain, car « pour accepter les conséquences de nos actions, nous concoctons toutes sortes de philosophies, défenses, aveuglements et mythes sur le monde et notre place en son sein. Malgré notre imagination pour créer des mécanismes de défense qui nous aident à gérer l’incohérence entre notre tête, notre cœur et nos mains, beaucoup parviennent cependant à rester honnêtes avec eux-mêmes » conclut-il avec pragmatisme.
Dans le premier chapitre intitulé Le guide de la violence pour les pacifistes, Mark Boyle rend compte du massacre organisé sur lequel repose notre fonctionnement contemporain. Il accroche l’imaginaire populaire avec quelques références efficaces, à l’image du ton général : « Seule une création satanique telle que Sauron, le Seigneur Noir de Mordor dans le légendaire de Tolkien ou une civilisation industrialisée pourrait transformer sans honte une planète diversifiée et prospère en une décharge de médiocrité plastique et de béton barbant en l’espace d’un clin d’œil cosmique ». Le recul est immédiat : cette pulvérisation du vivant, est-ce notre œuvre ? Oui. Celle des sociétés capitalistes et de leurs œillères.
« Pourtant, poursuit-il plus directement, pour des meubles bon marché, des consoles de jeux et des boissons gazeuses, nous avons réduit de complexes forêts en scieries, les montagnes en carrières, les océans en fermes de poissons appauvris et les rivières en centrales électriques ». Mais enfin, comme pour rappeler les fondements d’une observation maintes fois articulée depuis l’aube de la Révolution Industrielle (XIXème siècle) et à laquelle nous n’avons jamais suffisamment tendu l’oreille, il cite le philosophe allemand Heidegger (1889 – 1976) lorsque ce dernier déplorait déjà la réduction de la nature « à une gigantesque station-service ».

Cette agression perpétuelle et non-régulée de la vie est évidemment intenable. Nous en arrivons à bout. Les humains, comme les non-humains, en subissent désormais distinctement les limites, sonnant ainsi le glas d’un règne d’anéantissement jamais vu. Mais d’ici qu’il s’effondre et laisse sa place, si tant est qu’il la cède, doit-on prématurer son déclin par la violence ? Est-ce notre unique voie de secours ?
« Œil pour œil, nous finirons aveugles » mentionne l’ouvrage. Selon l’analogie, nous manquerions d’intelligence en répondant au feu par le feu. Mark Boyle soutient tout le contraire : la violence de la Machine est première, et la nôtre, celle des oppressés, tiendrait plutôt de la légitime défense. Il défendra même que la non-violence peut s’avérer complice, qu’elle n’a jamais permis autre chose qu’un état réformiste perpétuel creusant l’apathie caractéristique du confort moral et, par voie de faits, notre tombe. Raisonnement hâtif ? Sophisme dangereux ? Le théoricien ne manque pas de développer assidûment.
La violence des uns n’est pas celle des autres
« Il y a trois sortes de violence.
La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui écrase et humilie des millions d’hommes, la violence aux rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui se fait l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas pire hypocrisie que de n’appeler violence que la deuxième, en feignant d’oublier la première qui l’a fait naître et la troisième qui la nie ».
– Helder Camara
Dans son ouvrage, Mark Boyle concède ouvertement sa propre définition de la violence. Selon lui : « La violence est l’utilisation injustifiée de la force portant atteinte à une autre entité de façon intentionnelle ou coupable, ou insensible aux besoins de cette entité ou de l’ensemble dont elle fait partie. Elle englobe des actions qui, par une négligence délibérée, une complicité consciente indirecte, ou l’imposition d’une série de conditions, contribuent à porter atteinte à une autre entité ».
En ce sens, le théoricien s’attache à distinguer la force de la violence. Et il prend pour cela un exemple celui du dentiste. Un dentiste arrachant la dent malade d’un patient a irrémédiablement employé la force pour le faire. Mais personne ne tiendra à qualifier cet acte de « violent » étant donné qu’il a débarrassé le ou la patiente de son mal. L’auteur y oppose l’acte d’un tortionnaire qui sectionnerait la même dent, d’un même geste, mais contre le gré de sa victime et dans le but de lui soutirer des informations. Une agression éminemment violente. La distinction est rendue possible, explique Mark Boyle, du point de vue du consentement, mais également de l’intention.
Ce distinguo n’est évidemment pas suffisant. Le penseur s’emploie ainsi de longues pages durant à nuancer son propos, à le reprendre, le détailler, le fonder. Et voilà la véritable force de l’ouvrage qui lui permet de ne pas tomber dans les écueils du dogme, ni dans une posture de gourou. L’auteur nous invite simplement à repousser les limites de l’évidence, à repenser notre situation à la source, à la manière de Henry David Thoreau, dont il emprunte la métaphore inspirante : « ils sont un millier à couper les branches du mal contre un seul qui s’attaque à ses racines ».
Car en effet, combien de personnes brident leur indignation en s’arrêtant aux principes de loi parce qu’elles auraient en horreur toutes les manifestations de violences illégales, selon des mœurs qu’elles croient profondément universelles, justes et immuables ? Cette ferveur institutionnelle et/ou pacifiste est néanmoins tout autant le fruit de pensées préétablies que celles qu’on leur propose d’y substituer : une fabrication de l’esprit humain et de son décorum contemporain.
Mark Boyle souligne dès lors ce que le relativisme moral de Nietzsche introduisait déjà si bien dans Par-delà le bien et le mal (1886), ou ce que Rousseau tentait de nous faire comprendre quand il écrivait « Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes, et nul ne peut s’assurer qu’il aimera demain ce qu’il aime aujourd’hui ». Nous ne marchons jamais pour la vérité, mais pour des vérités données auxquelles nos affections instables donnent toute leur saveur. Et celle pour laquelle nous souffrons aujourd’hui nous hérite de figures tout à fait récentes au regard de l’Histoire de notre espèce, et en ce sens, loin de pouvoir essentialiser notre nature. Aujourd’hui, nous ne sommes certainement pas le résultat de notre inhérence à la prédation, mais simplement « les esclaves d’un quelconque économiste défunt » résume l’auteur en citant l’économiste John Maynard Keynes (1883-1946).
En outre, puisque la violence de la Machine est injuste, insoutenable et arriviste, pourquoi nous acharner à l’idolâtrer comme un parangon intemporel de société ? Nous sommes en droit, ouvre Mark Boyle, de la contester. Mieux : n’ayant pas le monopole du concept protéiforme de violence, cette société ne saurait nous voler – par des cabrioles rhétoriques – notre droit à nous défaire d’elle en utilisant cette occurrence qu’est la légitime défense.
Cette idée a déjà été largement exposée à bien des égards par d’autres philosophes, jusqu’à en faire un devoir citoyen : le corps civil ayant en réalité pour responsabilité de réguler le pouvoir de l’Etat (qu’il représente) quand celui-ci manque au sien de protéger le bien commun. Mais à partir de ce principe, Mark Boyle prend l’avantage de déployer avec une spontanéité rafraîchissante une multitude foisonnante d’axes plus intéressants les uns que les autres, dont celui de la réaction organique. Il habillera notamment son septième et avant dernier chapitre d’un espoir de Dave Foreman : « Il est temps qu’une société guerrière surgisse de la Terre et se jette devant le mastodonte de la destruction, comme des anticorps contre la variole humaine qui ravage cette précieuse et belle planète ». Le contraire étant, selon Mark Boyle – qui adhère à une vision active et prépondérante de la vie civique (dans le sillage du concept de « religion civile » de Rousseau) – potentiellement criminel.
La non-violence est complice de la Machine
« Pourrait-on commencer à envisager que notre absence d’action effective visant à les arrêter puisse être, en réalité, l’approche violente ? »

Pendant que nous gardons notre sang froid, explique Mark Boyle, en espérant réformer le capitalisme afin qu’il soit un peu plus social et juste (un paradoxe irréconciliable retrace-t-il), toujours plus d’espaces et d’existences sont dégradés, corrompus, en souffrance, à des points de non retour dramatiques. « On doit l’arrêter » reprend-il. Cette simple formule aurait pu suffire à synthétiser l’ensemble de l’ouvrage : « on », étant ce nous collectif qu’il s’agit de reformer par dignité humaine, le verbe devoir soulignant l’évidence oubliée d’affronter ce qui fait mal ; et ce qui fait mal, c’est ce pronom « l », cette créature mécanique qui nous a échappé, qui n’est plus question de la dévier, mais de freiner sans hésitation.
L’accompagner en espérant l’apprivoiser revient en réalité à l’accompagner tout de même. Et chaque pas à ses côtés, peu importe nos bonnes intentions, se transforme selon Mark Boyle, en complicité criminelle. Il enrobe bien entendu de nombreuses nuances ses accusations : notre complicité n’est possible que parce que le modèle lui-même nous y piège, et il n’y a de complicité volontaire que pour celui ou celle qui pourrait agir, en pleine conscience du vice, mais préfère s’y soumettre.
La lutte pacifiste est d’autant plus illusoire, reprend-il également, qu’elle tire son aura de faux récits de victoires mystifiées : toutes les révolutions efficaces ont été totales, au dialogue suivait toujours des actes de rébellion inarrêtables. C’est ce que nous rétablissions dans notre dossier sur l’échec de la non-violence concernant, par exemple, le souvenir édulcoré de Martin Luther King.
Pour convaincre les derniers réticents que la non-violence est un pion de la Machine, Mark Boyle invoque le poète mystique Rumi, lorsque celui-ci met en lumière cet espace au-delà du « bien faire » et du « mal faire » que nous avons tendance à déserter, cependant qu’il est le passage entre l’un et l’autre des deux extrêmes moraux. « C’est dans cet espace qu’une résistance digne envers la Machine peut commencer pour de bon » ajoute l’écrivain.
Exemples de violences légitimes pour sortir du monde des idées
La résistance est fertile. La résistance existe déjà. Elle jonche notre monde d’exploits à chaque minute de chaque heure et de chaque jour que nous le pensons condamné à son sort. Alors que Mark Boyle déroule sa pensée, il ne tarit pas non plus d’exemples concrets, de peuples, communautés, groupes, qui ont affronté ou désactivé le programme capitaliste.
La liste est longue. Elle va du peuple fictif d’Omelas qui doit réagir face à l’innommable, à ce village reculé d’Irlande rurale où l’arrivée du simple Thermos a détruit les liens sociaux (ce que Mark Boyle décrit comme un communicide), en passant par les attentats portés par les suffragettes, l’organisation des zapatistes au Chiapas, des révolutionnaires féministes et libertaires du Rojava, et par la mise en avant centrale de Marinaleda en Espagne, cet exploit de libération collective.

À un degré moindre, on pourrait aussi citer l’action des black blocs, du collectif La Ronce ou encore des Soulèvements de la Terre, qui revendiquent des actes de sabotage pour mettre la Machine hors d’état de nuire. Leur point commun ? Ils ne font finalement usage de la force qu’envers les rouages de la Machine. Bien sûr, il y a des effets collatéraux sur des lieux, des industries, des êtres, mais rien qui ne fusse pas déjà oppressé ou bien condamné par notre ordre sociétal, et jamais non plus au degré où ils l’étaient. C’est d’ailleurs étonnant, remarque l’auteur, à quel point nous nous sommes insensibilisés à la violence dystopique des institutions, de la domination politique, de l’exploitation animale, du joug industriel sur notre intégrité et notre santé, de la police, de la marchandisation et numérisation du monde, qui tuent et maltraitent massivement chaque année, pour s’offusquer si facilement d’un terrain occupé, d’une usine dégradée, ou d’une multinationale hackée.
La lutte écologiste et radicale est une réorganisation de fond dans un marasme insalubre : son émancipation tâche inévitablement. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces marques sont celles des mécanismes assoiffés qui s’agrippent. Elles sont incomparables à la puanteur à laquelle nous nous sommes habitués sous un vernis doré. Elles, ne tuent pas, ne blessent pas, mais révèlent. Les éclaboussures de la lutte radicale étant en somme le simple reflet de la violence de notre état présent.
L’auteur avertit tout de même : il n’est pas question de copier les modèles voisins, mais chaque fois d’adapter sa rébellion aux conditions et besoins de sa propre localité. Il s’agit finalement de renouer avec son environnement, de l’écouter de nouveau et de sentir au plus profond de soi la nécessité absolue de faire corps et d’y répondre.
Car c’est cette nécessité dont nous avons été amputés, à cause du confort superficiel que nous avons gagné par le « progrès ». Notre erreur ? Avoir troqué la difficulté de faire ensemble contre la facilité de faire seul. Or, faire ensemble était la clef du faire mieux. Ou, comme Mark Boyle reprend de Ran Prieur :
« Toute technologie commence par une clef et finit comme une cage ».
D’autant que cette course à la praticité technologique ne nous rend ni plus heureux, ni plus libres : plus nous gagnons en confort, plus nos vies sont scellées par des injonctions perverses au travail et à la consommation. Un supplice de Tantale morbide, où plus nous cédons à la soif, moins nous sommes rassasiés (voir L’Odyssée, chant XI, Homère).
Un livre qui active l’esprit critique
Boire des Cocktails Molotov avec Gandhi est incontestablement un ouvrage fondateur, dont les suites d’idées, c’est assez rare pour le souligner, réveillent instantanément l’esprit critique. Le ton, lui, ravive le souffle citoyen par un sentiment inexplicable d’appartenance au monde, du côté de la justesse de cœur et par amour pour ce tout vibrant que nous savons bel et bien former.
Il est un vivier de réflexions impressionnantes qui ne cherchent pas l’adhésion totale, mais la remise en doute de notre réalité morale. Ce qui n’est pas anodin.
Parfois, nous ne sommes pas d’accord, comme sur la binarité utilisée pour comparer l’industrie animale au mythe ancestral de la chasse et de la cueillette, respectivement considérés comme violent et non-violent, les chasseurs nomades respectant, selon Mark Boyle, le « Grand réseau de la Nature ». Sauf qu’ici, le penseur éclipse totalement de son exposé l’entre-deux incarné par l’alimentation végétale ou, encore, par le charognage, un régime marginal qui a cependant préexisté à la chasse dans l’histoire de notre évolution. Une personne inavertie pourrait ainsi aisément, via ce passage partiel, se compromettre dans des pratiques de chasse largement occidentalisées depuis le rêve d’Eden auquel l’ouvrage semble se référer malgré lui. Par ailleurs, l’adoption collective de cette posture carniste idéalisée, même avec parcimonie, viderait tout de même les écosystèmes de leurs vies fragilisées du fait de notre densité démographique. Une réflexion sur la composition de notre régime alimentaire, et non seulement sur notre manière de nous approvisionner, aurait donc été bienvenue. Une mention spéciale mérite toutefois d’être attribuée au dernier chapitre consacré au symbole du loup dans nos sociétés.
Et, en tout état de cause, comment reprocher à un ouvrage aussi dense de ne pas essorer l’ensemble des théories qu’il initie ? Boire des Cocktails molotov avec Gandhi reste d’utilité publique, un socle incontournable. Il doit servir à aiguiser notre activisme, nos réflexions et notre autonomie de pensée en se défaisant, in fine, des méditations de son auteur.
Pour poursuivre ces réflexions, le livre Boire des Cocktails Molotov avec Gandhi de Mark Boyle (Editions Nautilus) peut être obtenu en librairies indépendantes.
– S.H

















